- Communication du CEO
- Formation LinkedIn
- Live LinkedIn
- Leader Advocacy
- Newsletter LinkedIn
- Personal Branding / Marque personnelle
- Stratégie LinkedIn


«Aujourd'hui, en termes de temps, on est devenu des mines à ciel ouvert. Plus on passe de temps à répondre aux sollicitations numériques, plus on nous hameçonne.»«« La longueur permet de reprendre la main sur cette lassitude. »»L'exemple le plus récent de la fiabilité de ce
raisonnement est le succès du Joker :
avec des plans 8 à 10 fois plus longs qu'un Avengers et une intrigue complexe, le film a su séduire un public
attiré ces dix dernières années par des scènes d'action rapides et des émotions
vives et instantanées. En somme : la qualité prime sur la quantité !
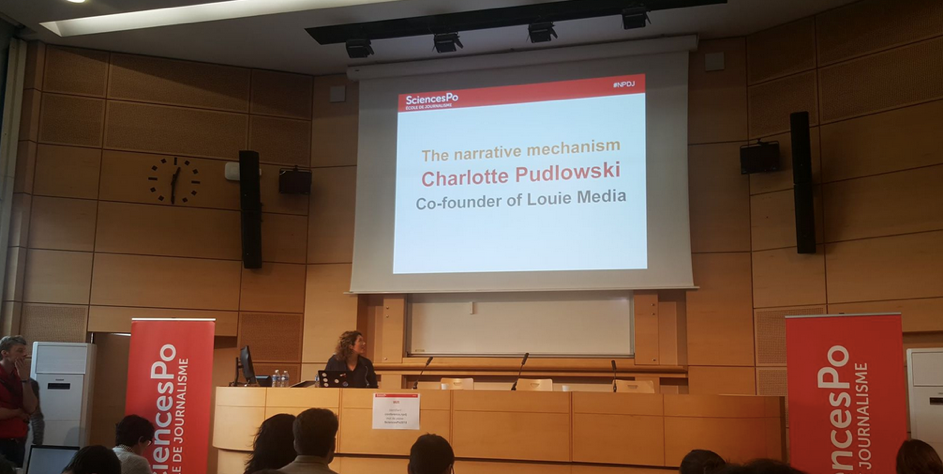
«Pour Justine, c'était parce qu'elle n'était pas un archétype qu'elle est devenue un vrai personnage»
«La newsletter à 6 heures du matin, c'est ça qui fait lire des papiers de 10 000 à 20 000 signes»«Le long format sert à enrichir le récit du réel»En tant qu'ancien éditeur des pages
Enquêtes du Monde, Serge Michel insiste
sur la liberté de ton et le besoin d'avoir de vrais personnages (rejoignant
ainsi les propos de Charlotte Pudlowski) lors des longs formats : « Je me souviens avoir eu de super reportages
avec de belles photos. Mais le traitement des personnages est laissé de côté.
Le journaliste passe généralement une heure ou deux avec son interlocuteur et
la rencontre se résume à deux citations. » Pour le journaliste,
« il y a une pauvreté dans la presse
en général de ce que sont les personnages : leur complexité, leur
évolution ». Ce qui importe aujourd'hui est de se libérer des « formes très formatées » et de « sortir des barrières mentales sur
les genres journalistiques » : « Si on a 6 ou 12 épisodes pour raconter une histoire, il faut aussi
bien mixer les dialogues que les descriptions. Il y a très peu de dialogues
aujourd'hui dans la presse. Le long
format sert à enrichir le récit du réel. » 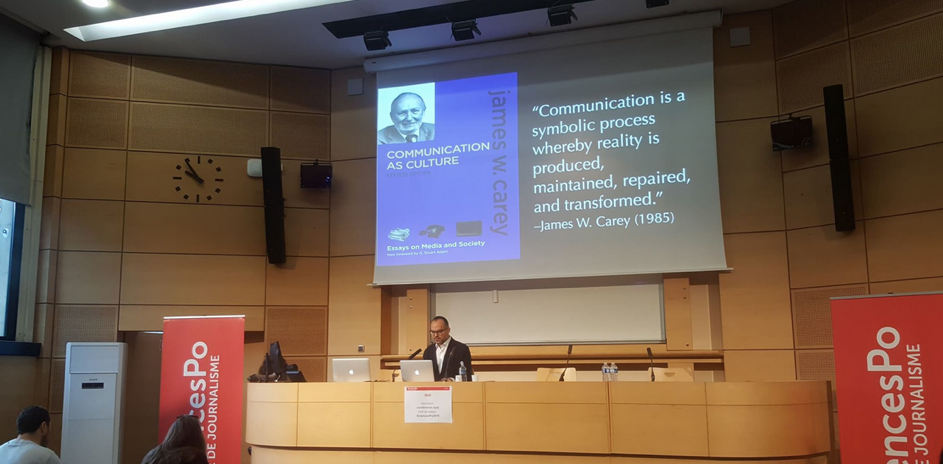
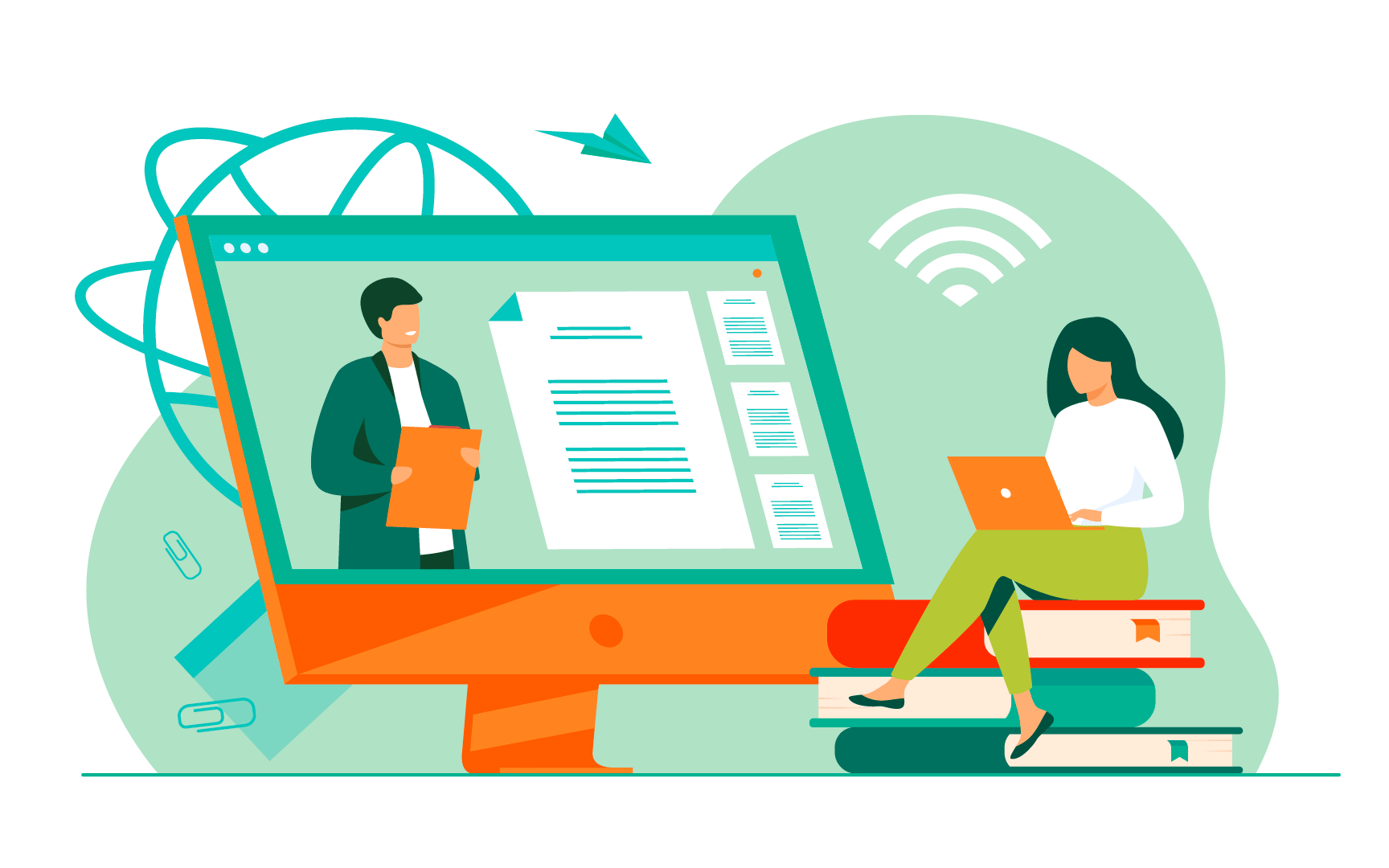
Ne ratez pas nos évènements, webinaires en ligne ou petits déjeuner bien physiques
>> Recevez nos invitations aux webinairesCette année, Story Jungle a de nouveau fait le voyage jusqu'à Sciences Po Paris pour assister à la conférence 2022 des Nouvelles Pratiques du Journalisme...
Cette année, Story Jungle a de nouveau fait le voyage jusqu'à Sciences Po Paris pour assister à la conférence 2022 des Nouvelles Pratiques du Journalisme. Le thème de cette 14e édition ? Informer à l'ère de TikTok.
Il aime la littérature avant le journalisme. Et pourtant, depuis un an et demi, il est à la tête du média d'extrême gauche Blast. Frappé par �...
Il aime la littérature avant le journalisme. Et pourtant, depuis un an et demi, il est à la tête du média d'extrême gauche Blast. Frappé par « la violence de l'État macronien », Denis Robert a décidé de reprendre le flambeau de l'info.
« Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. » C'est par ces mots de Winston Churchill que Mathias Vicherat,...
« Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. » C'est par ces mots de Winston Churchill que Mathias Vicherat, directeur de l'Institut d'études politiques de Sciences Po a ouvert la 12e édition des Nouvelles pratiques du journalisme, consacrée cette année à la reconquête du terrain.
Au sein du CELSA, le 26 janvier dernier, a eu lieu la 13e édition de la Conférence nationale des métiers du journalisme. Le thème de cette année : l'information à l'ère...
Au sein du CELSA, le 26 janvier dernier, a eu lieu la 13e édition de la Conférence nationale des métiers du journalisme. Le thème de cette année : l'information à l'ère de l'influence et du branding sur les réseaux. Story Jungle fait un récap' de la journée.
La SNCF a lancé une campagne de communication sur TikTok afin de faire découvrir aux plus jeunes des métiers peu connus de l'entreprise : agent d'escale,...
La SNCF a lancé une campagne de communication sur TikTok afin de faire découvrir aux plus jeunes des métiers peu connus de l'entreprise : agent d'escale, électricien haute tension ou encore conducteur de train.
Prix Albert-Londres de reportage en 2001 pour son travail en Iran, rédacteur en chef adjoint du Temps et directeur adjoint du Monde, fondateur de Bondy Blog,...
Prix Albert-Londres de reportage en 2001 pour son travail en Iran, rédacteur en chef adjoint du Temps et directeur adjoint du Monde, fondateur de Bondy Blog, le journaliste Serge Michel a cofondé Heidi.news, un nouveau média suisse. La publication s'articule autour de « flux » – des articles thématiques rapides à lire –, des « explorations », enquêtes qui se déroulent sur plusieurs épisodes et une newsletter quotidienne, pierre angulaire du média. Pour Story Jungle, Serge Michel évoque l'importance de la complémentarité des formats, la newsletter pensée comme un média à part entière, et la « standardisation des articles » en général. Entretien.
Long portrait dans Le Monde, « entretien monstre » en une du magazine Society, articles et brèves qui se multiplient un peu partout sur le net.....
Long portrait dans Le Monde, « entretien monstre » en une du magazine Society, articles et brèves qui se multiplient un peu partout sur le net... Difficile de passer à côté de Squeezie cette semaine. Le youtubeur aux 18,7 millions d'abonnés sort une série documentaire qui, au-delà de retracer son parcours, en dit long sur le quotidien des créateurs de contenu.
C'est un « voyage au bout de l'info » que propose l'entrepreneur, et auteur, journaliste spécialisée dans les usages de l'intelligence artificielle Benoit Rapha�...
C'est un « voyage au bout de l'info » que propose l'entrepreneur, et auteur, journaliste spécialisée dans les usages de l'intelligence artificielle Benoit Raphaël dans son livre « Information : l'indigestion », un manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info, publiée aux éditions Eyrolles.
Le métier passion consume tout autant qu'il fait vibrer. C'est cette relation ambivalente que décortique Anne-Claire Genthialon dans Le piège du métier passion,...
Le métier passion consume tout autant qu'il fait vibrer. C'est cette relation ambivalente que décortique Anne-Claire Genthialon dans Le piège du métier passion, publié aux éditions Alisio.
Il possède le Sun, le Wall Street Journal, Fox News... : à l'âge de 91 ans, Rupert Murdoch reste l'un des hommes les plus influents de la planète et... �...
Il possède le Sun, le Wall Street Journal, Fox News... : à l'âge de 91 ans, Rupert Murdoch reste l'un des hommes les plus influents de la planète et... « un cancer pour la démocratie ». L'historien David Colon lui consacre une biographie prenante, sur fond de concentration des médias : Rupert Murdoch, l'empereur des médias qui manipule le monde, publiée aux éditions Tallandier.
Comme chaque année, le Nieman Lab, le laboratoire du journalisme de Harvard, met en avant les prédictions médias des personnes les plus « brillantes »...
Comme chaque année, le Nieman Lab, le laboratoire du journalisme de Harvard, met en avant les prédictions médias des personnes les plus « brillantes » du milieu du journalisme américain. Voici notre sélection.
Une application gamifiée et interactive, avec des news du jour, développée spécialement pour la génération Z. Tel est le pari de Splash, l'application imaginée par Maxime...
Une application gamifiée et interactive, avec des news du jour, développée spécialement pour la génération Z. Tel est le pari de Splash, l'application imaginée par Maxime Voisin et Hugo Travers, de la chaîne YouTube HugoDécrypte. Disponible sur l'App Store et le Google Store, elle vise à réconcilier les jeunes avec l'information en leur proposant un récap clair, condensé et personnalisé, sous la forme de fiches et de stories vidéo. Interview avec Maxime Voisin sur cette application très moderne.
Pour sa cinquième édition, le festival Médias en Seine, organisé par Les Échos, Le Parisien et Franceinfo, a réuni près de 6000 participants et 200 intervenants français...
Pour sa cinquième édition, le festival Médias en Seine, organisé par Les Échos, Le Parisien et Franceinfo, a réuni près de 6000 participants et 200 intervenants français et internationaux, autour d'un thème très large : «Médias, quelles responsabilités, quelles réponses par temps de crise?» Retour choisi sur une riche édition.
Une collection de 5 podcasts de 70 épisodes chacun, soit 350 podcasts au total. Le studio de podcast La Toile sur Écoute a vu grand, avec sa série « Power Angels »,...
Une collection de 5 podcasts de 70 épisodes chacun, soit 350 podcasts au total. Le studio de podcast La Toile sur Écoute a vu grand, avec sa série « Power Angels », des contenus de trois à quatre minutes animés par 5 expertes pour améliorer ses compétences digitales.
« Les médias vont un peu mieux que ce que l'on pourrait croire », affirme David Barroux, rédacteur en chef des Echos, en guise de préambule à la 4e édition de Médias en...
« Les médias vont un peu mieux que ce que l'on pourrait croire », affirme David Barroux, rédacteur en chef des Echos, en guise de préambule à la 4e édition de Médias en Seine, organisée ce mardi 12 octobre par Les Echos et Franceinfo.
Ils sont de plus en plus nombreux à rendre leurs tabliers. Les journalistes, désenchantés ? C'est le constat du sociologue Jean-Marie Charon dans son nouvel essai "Hier,...
Ils sont de plus en plus nombreux à rendre leurs tabliers. Les journalistes, désenchantés ? C'est le constat du sociologue Jean-Marie Charon dans son nouvel essai "Hier, journalistes".
Claire Touzard est celle qui ose. Après avoir brisé le tabou de l'addiction à l'alcool dans le pays où le verre de vin est roi, dans un journal de bord intitulé Sans alcool...
Claire Touzard est celle qui ose. Après avoir brisé le tabou de l'addiction à l'alcool dans le pays où le verre de vin est roi, dans un journal de bord intitulé Sans alcool, elle s'attaque dans Féminin, un roman d'auto-fiction ,au modèle économique de la presse féminine, et dans une plus large mesure au capitalisme.
L'application ChatGPT représente-t-il une menace pour l'univers de la communication et des médias ? Story Jungle fait le point sur cette fascinante intelligence artificielle...
L'application ChatGPT représente-t-il une menace pour l'univers de la communication et des médias ? Story Jungle fait le point sur cette fascinante intelligence artificielle.
Pour ce deuxième numéro, Story Jungle accueille Joël Ronez, président et cofondateur de Binge Audio, un des premiers studios en France de podcast natif...
Pour ce deuxième numéro, Story Jungle accueille Joël Ronez, président et cofondateur de Binge Audio, un des premiers studios en France de podcast natif. Ce vétéran des médias, passé par le pôle numérique d'Arte et ex-directeur des nouveaux médias de Radio France, revient sur les coulisses d'un projet né fin 2016 et haut-parleur des causes sociétales.
Après Twitter, Meta vient d'officialiser le plus important plan social en valeur absolue dans cette industrie ces dernières années.
Après Twitter, Meta vient d'officialiser le plus important plan social en valeur absolue dans cette industrie ces dernières années.
Le mensuel Science et Vie, propriété de Reworld Media (Biba, Grazia...), s'est vidé peu à peu de sa rédaction après s'être transformé en usine à contenus...
Le mensuel Science et Vie, propriété de Reworld Media (Biba, Grazia...), s'est vidé peu à peu de sa rédaction après s'être transformé en usine à contenus. Les anciens journalistes font volte-face et créent leur propre magazine d'actualité scientifique à paraître le 26 juin, baptisé Epsiloon. Hervé Poirier, ex-rédacteur en chef de Science et Vie, revient sur ce nouveau projet dont il est à l'origine.
Après avoir travaillé pendant près de quinze ans pour la presse en ligne – ELLE, L'Obs, Sciences et Avenir mais aussi Challenges où elle a occupé le poste de Directrice...
Après avoir travaillé pendant près de quinze ans pour la presse en ligne – ELLE, L'Obs, Sciences et Avenir mais aussi Challenges où elle a occupé le poste de Directrice numérique déléguée –, Marion Wyss a aujourd'hui fondé sa propre société. Avec l'éditeur de paywall dynamique Poool, elle a lancé Underlines, une agence qui conseille les éditeurs sur les stratégies de revenus. Pour Story Jungle, elle nous livre sa vision sur le futur économique de la presse. Un avenir qui dépendra – entre autres – de la qualité des contenus des médias.
Le futur se trouve dans le long format. Malmené par les réseaux sociaux, fatigué par des sollicitations incessantes, abonné à des contenus « snackables », le public est...
Chacune de leurs enquêtes est une bombe. L'équipe des Visual Investigations du New York Times est spécialisée dans la vérification des faits avec pour matière première les...
Chacune de leurs enquêtes est une bombe. L'équipe des Visual Investigations du New York Times est spécialisée dans la vérification des faits avec pour matière première les données libres d'accès sur le Net. Créé en 2017, le service a déjà reçu son prix Pulitzer en 2020. Malachy Brown, Senior Producer des Visual Investigations du New York Times, s'est prêté au jeu de l'interview pour Story Jungle. Il y évoque les coulisses de grandes enquêtes et donne des outils très utiles pour ceux qui souhaitent se lancer dans la course à l'enquête visuelle.
Jessica Anderson est senior editor au service newsletters du New York Times. Aux côtés d'Elisabeth Goodridge, directrice de la rédaction de cette rubrique un peu spéciale,...
Jessica Anderson est senior editor au service newsletters du New York Times. Aux côtés d'Elisabeth Goodridge, directrice de la rédaction de cette rubrique un peu spéciale, elle participe à la création des newsletters du célèbre quotidien américain. Comment la rédaction parvient-elle à innover continuellement ? Interview de Jessica Anderson, senior staff editor au service newsletters du New York Times.
Pendant dix ans, il a été notamment le Directeur de la marque et de la publicité du groupe Capgemini, un des leaders mondiaux et première entreprise de services du numérique...
Pendant dix ans, il a été notamment le Directeur de la marque et de la publicité du groupe Capgemini, un des leaders mondiaux et première entreprise de services du numérique en France. Emmanuel Lochon est aujourd'hui Chief Marketing Officer de Capgemini Invent, la nouvelle marque lancée il y a 18 mois. Pour Story Jungle, il témoigne des évolutions inhérentes au digital pour les marques, de l'importance de la donnée et de la communication personnalisée, à l'ère des experts et de la prédominance du contenu .
Du 18 au 19 mai, « Stratégies » a organisé une série de conférences autour des nouveaux formats qui « révolutionnent les médias ». Compte rendu des tables rondes.
Du 18 au 19 mai, « Stratégies » a organisé une série de conférences autour des nouveaux formats qui « révolutionnent les médias ». Compte rendu des tables rondes.
C'est une des figures les plus emblématiques du PAF. Bruno Patino, aujourd'hui directeur éditorial d'Arte et directeur de l'Ecole de journalisme de Sciences Po,...
C'est une des figures les plus emblématiques du PAF. Bruno Patino, aujourd'hui directeur éditorial d'Arte et directeur de l'Ecole de journalisme de Sciences Po, connaît par coeur les rouages d'un paysage médiatique complexe. Pour le second podcast de Story Jungle, il nous livre son point de vue d'expert aussi bien sur la révolution numérique, la crise dans les médias, que sur la montée en puissance des plateformes de streaming, et les formats innovants développés par la chaîne franco-allemande. Il faut dire que les sujets ne manquent pas avec ce professionnel très prolifique, qui est passé par tous les médias : presse quotidienne, radio, web et télévision. Rencontre.
Le rapport annuel du Reuters Institute – le centre de recherche en journalisme de l'université d'Oxford – avec ses observations et ses prédictions pour l'année à venir...
Le rapport annuel du Reuters Institute – le centre de recherche en journalisme de l'université d'Oxford – avec ses observations et ses prédictions pour l'année à venir vient de sortir. L'étude, très riche, s'appuie sur le témoignage de 234 leaders des médias digitaux – rédacteurs en chef, Managing Directors, Heads of Digital... – de 43 pays. Quelles priorités se dessinent pour l'année 2021 en termes de narration ?
Jamais les médias n'ont été autant lus, regardés, consommés. Face à une crise sanitaire sans précédent, ils ont joué un rôle d'accompagnateur auprès d'une audience avide...
Jamais les médias n'ont été autant lus, regardés, consommés. Face à une crise sanitaire sans précédent, ils ont joué un rôle d'accompagnateur auprès d'une audience avide de décryptages et d'informations pratiques.
Comment produire des formats efficaces, en période de confinement ? Si le secteur événementiel en a pris un coup – rappelons que d'innombrables grands événements ont été...
Comment produire des formats efficaces, en période de confinement ? Si le secteur événementiel en a pris un coup – rappelons que d'innombrables grands événements ont été annulés ou repoussés (China Connect, E-marketing Paris 2020, Big Data Paris, Mobile World Congress à Barcelone, Global Marketing Summit de Facebook à San Francisco...) –, d'autres canaux de communication existent et se renforcent. Avec les moyens du bord. Story Jungle a dressé pour vous une liste de formats et d'outils plébiscités, à l'ère du coronavirus.
BBC World Service innove. La chaîne anglophone a publié son premier documentaire Instagram : une nouvelle façon de s'engager et d'attirer une audience plus jeune sur la plateforme...
BBC World Service innove. La chaîne anglophone a publié son premier documentaire Instagram : une nouvelle façon de s'engager et d'attirer une audience plus jeune sur la plateforme. The Instagram witches of Brooklyn - un reportage en format vertical de 10 minutes - nous fait découvrir le mouvement spirituel de la « brujeria » (sorcellerie) qui a gagné en popularité grâce à Instagram. La réalisatrice et journaliste à la BBC, Sophia Smith Galer évoque avec nous l'attrait de la plateforme. Très présente sur TikTok (78 000 abonnés), elle nous parle également de l'importance de plus en plus forte de l'application chinoise dans la diffusion d'informations.
LinkedIn dévoile une nouvelle fonctionnalité permettant de sponsoriser les articles LinkedIn publiés sur les pages entreprises.
LinkedIn dévoile une nouvelle fonctionnalité permettant de sponsoriser les articles LinkedIn publiés sur les pages entreprises.
En 2023, les budgets publicitaires dédiés à la notoriété des marques ont en partie basculé vers la marque employeur. Si le concept s'avère être un levier puissant pour...
En 2023, les budgets publicitaires dédiés à la notoriété des marques ont en partie basculé vers la marque employeur. Si le concept s'avère être un levier puissant pour attirer et conserver les talents tout en soignant l'image de l'entreprise, il est parfois mal assimilé par les collaborateurs en interne.
Qui dit confinement, dit formats bidouille. Non ? En tout cas, sur ce sujet, les marques pourront chercher des sources d'inspiration dans l'étude de Talkwalker et HubSpot,...
Qui dit confinement, dit formats bidouille. Non ? En tout cas, sur ce sujet, les marques pourront chercher des sources d'inspiration dans l'étude de Talkwalker et HubSpot, qui ont interrogé des leaders de l'industrie, des experts et des influenceurs sur les tendances réseaux sociaux pour l'année à venir. Où l'on parle de l'art du remixing C'est-à-dire le fait de réinventer des formats, des modèles ou concepts existants pour s'exprimer au travers des applications telles que TikTok ou Reels sur Instagram.
« L'actualité simple, basique et en musique. » Depuis le 15 juin 2020, le journal Le Monde a investi l'application la plus téléchargée de 2019, TikTok,...
« L'actualité simple, basique et en musique. » Depuis le 15 juin 2020, le journal Le Monde a investi l'application la plus téléchargée de 2019, TikTok, avec des vidéos pédagos et ludiques. Un canal utilisé pour atteindre un nouveau public, la génération Z, qui bien souvent ne connaît pas ce quotidien vénérable.
Depuis 2000, Thomas Karolak s'emploie à convertir les médias au numérique. Il est aujourd'hui le Chief Digital Officer (CDO) du groupe Les Echos. Pendant dix-huit mois,...
Depuis 2000, Thomas Karolak s'emploie à convertir les médias au numérique. Il est aujourd'hui le Chief Digital Officer (CDO) du groupe Les Echos. Pendant dix-huit mois, il a mené tambour battant la refonte du site du plus grand média économique de France. Une expérience digitale intense sur laquelle il revient pour Story Jungle. Entretien.
Take part Media, leader en France sur le segment des cibles B2B et premium, qui édite depuis 2 ans le média dédié aux nouvelles narrations, Story Jungle,...
Take part Media, leader en France sur le segment des cibles B2B et premium, qui édite depuis 2 ans le média dédié aux nouvelles narrations, Story Jungle, regroupe ses 2 entités sous une seule marque: Story Jungle, un média, une agence. Avec pour ambition de mener la guerre contre l'eau tiède.
Il est le cofondateur d'Axios. Il est l'auteur des newsletters quotidiennes Axios AM et Axios PM, et il couvre les nouvelles les plus importantes de la journée
Il est le cofondateur d'Axios. Il est l'auteur des newsletters quotidiennes Axios AM et Axios PM, et il couvre les nouvelles les plus importantes de la journée
Depuis 2013, il travaille dans le journalisme numérique et le développement de l'audience. Francesco Zaffarano est passionné par l'univers des médias et de l'innovation...
Depuis 2013, il travaille dans le journalisme numérique et le développement de l'audience. Francesco Zaffarano est passionné par l'univers des médias et de l'innovation. Il a été Instagram Producer chez The Economist, Social Media Editor chez Telegraph, Assistant video producer chez Vice Media ou encore journaliste au Corriere della Serra.
Comme chaque année, le Reuters Institute déroule les tendances à venir pour l'industrie des médias. S'appuyant sur le témoignage de 303 acteurs – rédacteurs en chef,...
Comme chaque année, le Reuters Institute déroule les tendances à venir pour l'industrie des médias. S'appuyant sur le témoignage de 303 acteurs – rédacteurs en chef, directeurs généraux, responsables du numérique et de l'innovation – de 53 pays, l'étude s'interroge sur la viabilité des médias, dans un contexte plus qu'incertain : inflation galopante, lassitude des lecteurs face à une couverture médiatique anxiogène, désintérêt des plateformes sociales pour l'actu, retrait des annonceurs, hausse du coût du papier.
S'il est bien un sujet qui ne supporte pas l'eau tiède, c'est le climat. La preuve : quand il s'agit de la crise climatique, entreprises et presse communiquent sans cesse.....
S'il est bien un sujet qui ne supporte pas l'eau tiède, c'est le climat. La preuve : quand il s'agit de la crise climatique, entreprises et presse communiquent sans cesse... sans jamais convaincre totalement. Le 21e Cahier des Tendances de Méta-Media s'est penché sur le cas particulier des médias : face à la crise climatique, font-ils vraiment le job ?
LinkedIn renforce sa présence éditoriale en développant ses rédactions dans le monde. Désormais, des journalistes produisent un contenu inédit (podcasts, vidéos,...
LinkedIn renforce sa présence éditoriale en développant ses rédactions dans le monde. Désormais, des journalistes produisent un contenu inédit (podcasts, vidéos, articles), tout en réalisant une curation de l'actualité proposée par les membres de la plateforme. Interview de Sandrine Chauvin, rédactrice en chef LinkedIn Europe, qui développe le concept de journalisme conversationnel.
Per Westergaard et Søren Schultz Jørgensen sont journalistes. Ils sont allés à la rencontre de 54 rédactions occidentales pour comprendre les nouveaux usages du journalisme...
Per Westergaard et Søren Schultz Jørgensen sont journalistes. Ils sont allés à la rencontre de 54 rédactions occidentales pour comprendre les nouveaux usages du journalisme. De leurs observations, ils ont tiré un livre "Den journalistiske Forbindelse" (pour le moment disponible uniquement en danois). Ils nous expliquent comment les médias peuvent faire face à la transformation digitale et à la défiance grandissante du public pour le travail journalistique.
Juliette Nouel est une journaliste spécialisée dans les enjeux climatiques, animatrice de débats sur le sujet et à l'initiative de formations et d'associations sensibilisant...
Juliette Nouel est une journaliste spécialisée dans les enjeux climatiques, animatrice de débats sur le sujet et à l'initiative de formations et d'associations sensibilisant au réchauffement climatique.
Avec 214 00 abonnés, le chroniqueur David Abiker s'est forgé une belle communauté sur LinkedIn
Avec 214 00 abonnés, le chroniqueur David Abiker s'est forgé une belle communauté sur LinkedIn
Depuis le 15 septembre, le média propose une nouvelle version de son édition quotidienne publiée sur la plateforme. L'objectif ? Se rapprocher de son audience en misant sur...
Depuis le 15 septembre, le média propose une nouvelle version de son édition quotidienne publiée sur la plateforme. L'objectif ? Se rapprocher de son audience en misant sur le format vidéo incarnée et casser cette image de journaliste star, enfermé dans sa tour d'ivoire.Un des changements majeurs reste la disparition du format "story" - une succession de snaps de dix secondes - au profit d'un format vidéo de quatre minutes, le Snapshow. Olivier Laffargue, responsable des éditions Snapchat/TikTok du Monde, est revenu pour Story Jungle sur les enjeux de cette mutation, plus "profonde" que les précédentes.
Publishers, voici vos armes pour détrôner YouTube et NetflixLe service de recherche et de développement de la BBC a planché pendant un an sur de nouveaux formats...
Membre du comité exécutif de L'Oréal, Jean-Claude Le Grand incarne depuis des années une fonction RH qui est devenue stratégique pour toute grande entreprise qui se respecte...
Membre du comité exécutif de L'Oréal, Jean-Claude Le Grand incarne depuis des années une fonction RH qui est devenue stratégique pour toute grande entreprise qui se respecte.
Story Jungle est une agence indépendante, leader du Content marketing à destination des cibles premium et B2B et un média dédié aux nouvelles narrations.
Story Jungle est une agence indépendante, leader du Content marketing à destination des cibles premium et B2B et un média dédié aux nouvelles narrations.
Suivez-nous
|