- Communication du CEO
- Formation LinkedIn
- Live LinkedIn
- Leader Advocacy
- Newsletter LinkedIn
- Personal Branding / Marque personnelle
- Stratégie LinkedIn

«Quelque chose devait être fait pour rendre au journalisme ses lettres de noblesse et restaurer son aura.» 
«Rapprochez-vous de vos lecteurs, écoutez-les, impliquez-les, invitez-les et demandez-leur de l'aide. »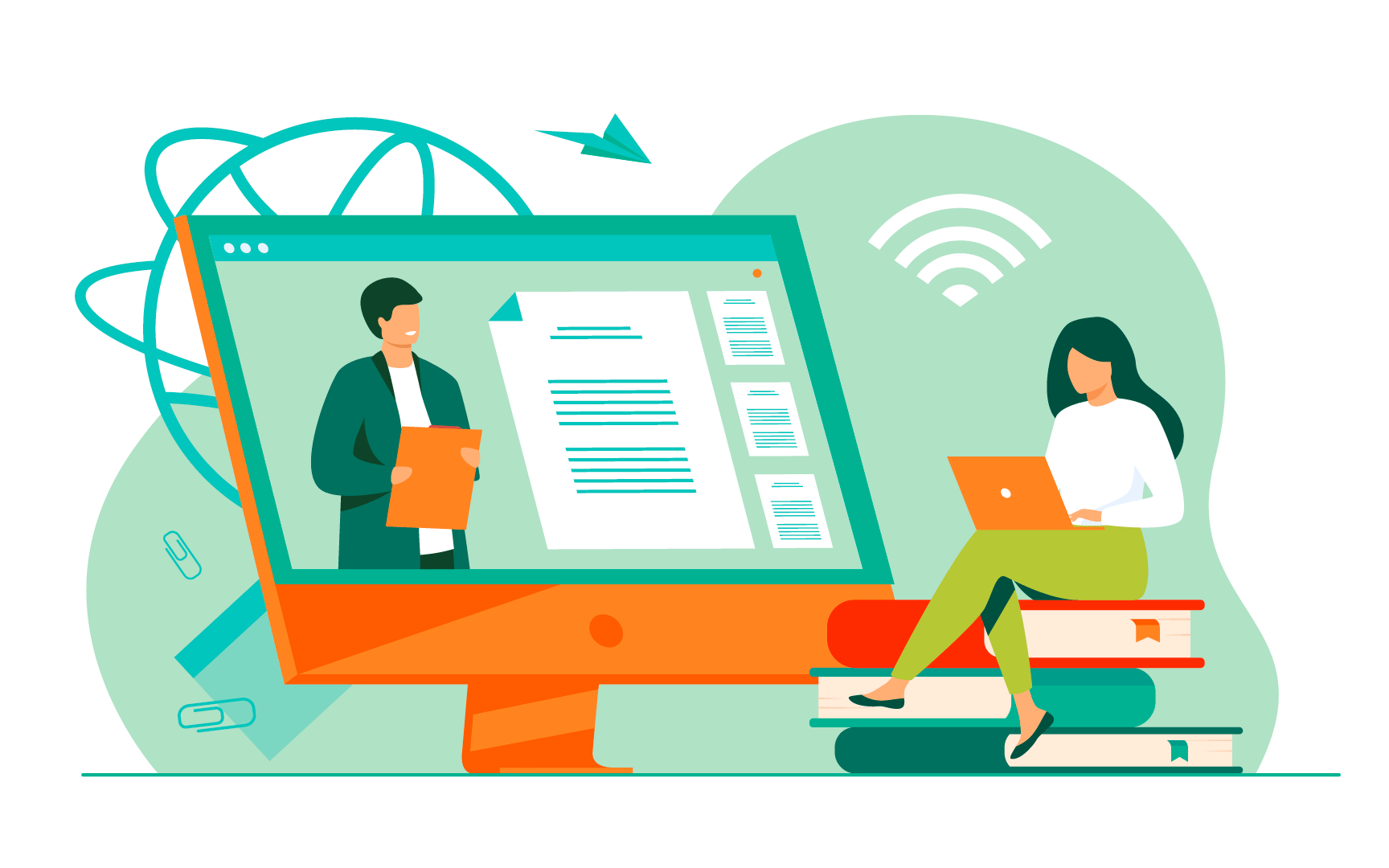
Ne ratez pas nos évènements, webinaires en ligne ou petits déjeuner bien physiques
>> Recevez nos invitations aux webinairesC'est un « voyage au bout de l'info » que propose l'entrepreneur, et auteur, journaliste spécialisée dans les usages de l'intelligence artificielle Benoit Rapha�...
C'est un « voyage au bout de l'info » que propose l'entrepreneur, et auteur, journaliste spécialisée dans les usages de l'intelligence artificielle Benoit Raphaël dans son livre « Information : l'indigestion », un manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info, publiée aux éditions Eyrolles.
Le site d'information BuzzFeed News ferme ses portes. C'est ce qu'a annoncé la direction du groupe de divertissement BuzzFeed, jeudi 20 avril.
Le site d'information BuzzFeed News ferme ses portes. C'est ce qu'a annoncé la direction du groupe de divertissement BuzzFeed, jeudi 20 avril.
Au sein du CELSA, le 26 janvier dernier, a eu lieu la 13e édition de la Conférence nationale des métiers du journalisme. Le thème de cette année : l'information à l'ère...
Au sein du CELSA, le 26 janvier dernier, a eu lieu la 13e édition de la Conférence nationale des métiers du journalisme. Le thème de cette année : l'information à l'ère de l'influence et du branding sur les réseaux. Story Jungle fait un récap' de la journée.
Les différentes études publiées par Médiamétrie le confirment : les smartphones continuent de booster la consommation de formats audio dans l'Hexagone,...
Les différentes études publiées par Médiamétrie le confirment : les smartphones continuent de booster la consommation de formats audio dans l'Hexagone, où plus de la moitié des contenus sont désormais écoutés sur des supports numériques...
Dans le vaste monde des spécialistes tech et réseaux sociaux, Matt Navarra est une pointure. Un type qui annonce les infos des GAFAM avant les GAFAM... Un oracle, donc.
Dans le vaste monde des spécialistes tech et réseaux sociaux, Matt Navarra est une pointure. Un type qui annonce les infos des GAFAM avant les GAFAM... Un oracle, donc.
Depuis 2013, il travaille dans le journalisme numérique et le développement de l'audience. Francesco Zaffarano est passionné par l'univers des médias et de l'innovation...
Depuis 2013, il travaille dans le journalisme numérique et le développement de l'audience. Francesco Zaffarano est passionné par l'univers des médias et de l'innovation. Il a été Instagram Producer chez The Economist, Social Media Editor chez Telegraph, Assistant video producer chez Vice Media ou encore journaliste au Corriere della Serra.
Quels sont les secrets des experts de la com' ? Que font-ils derrière leur ordinateur ? Story Jungle propose une rencontre de ceux qui sont au cœur des stratégies de contenus...
Quels sont les secrets des experts de la com' ? Que font-ils derrière leur ordinateur ? Story Jungle propose une rencontre de ceux qui sont au cœur des stratégies de contenus ! Retrouvez notre invitée de notre format « Tu bosses sur quoi ? »: Aline Geffroy, Global Social Media Director chez Saint-Gobain
Il aime la littérature avant le journalisme. Et pourtant, depuis un an et demi, il est à la tête du média d'extrême gauche Blast. Frappé par �...
Il aime la littérature avant le journalisme. Et pourtant, depuis un an et demi, il est à la tête du média d'extrême gauche Blast. Frappé par « la violence de l'État macronien », Denis Robert a décidé de reprendre le flambeau de l'info.
Après un (long) temps d'observation, peut-être dû à la sidération, les décideurs - principalement les patrons - s'engagent dans la campagne...
Après un (long) temps d'observation, peut-être dû à la sidération, les décideurs - principalement les patrons - s'engagent dans la campagne. Non sans quelques sueurs froides à l'idée de braquer une partie de leurs audiences, clients ou collaborateurs.
Avec des événements d'ampleur comme les Jeux olympiques de Paris ou l'Euro de football, l'été 2024 s'annonce riche en exploits comme en audiences sportives...
Avec des événements d'ampleur comme les Jeux olympiques de Paris ou l'Euro de football, l'été 2024 s'annonce riche en exploits comme en audiences sportives. Et pour embarquer la jeunesse avec lui, le sport fait désormais équipe avec des streamers. Sur tous les écrans...
Mélissa Lambert, Social Media Manager chez Welcome to the Jungle, lève le voile sur un métier parfois compliqué à appréhender : elle y évoque ses tâches quotidiennes,...
Mélissa Lambert, Social Media Manager chez Welcome to the Jungle, lève le voile sur un métier parfois compliqué à appréhender : elle y évoque ses tâches quotidiennes, ses insights sur Facebook, Twitter, LinkedIn et TikTok.
Gilles Tanguy a fondé L'Informé avec l'ambition de faire all-in sur l'information exclusive. L'Informé est « un média d'investigation économique libre, factuel et sans pub...
Gilles Tanguy a fondé L'Informé avec l'ambition de faire all-in sur l'information exclusive. L'Informé est « un média d'investigation économique libre, factuel et sans pub », comme le dit la baseline. Il publie 4 à 5 scoops par jour, soit déjà plus de 2 500 depuis le lancement en octobre 2022.
Depuis qu'il s'est installé en coworking dans la maison blanche, Elon Musk use de toute son influence pour contraindre les marques à revenir sur X,...
Depuis qu'il s'est installé en coworking dans la maison blanche, Elon Musk use de toute son influence pour contraindre les marques à revenir sur X, dont les recettes publicitaires ont été largement siphonnées après le rachat de la plateforme en 2022 par le nouveau « go-to guy » de l'administration Trump...
Nous sommes mi-janvier et le prix de la campagne la plus absurde de l'année vient déjà de tomber...
Nous sommes mi-janvier et le prix de la campagne la plus absurde de l'année vient déjà de tomber...
Pour gagner le droit de passer à nouveau la porte de la Maison Blanche, Donald Trump a déployé une campagne digitale poussée à l'extrême, qui a brisé les codes et repoussé...
Pour gagner le droit de passer à nouveau la porte de la Maison Blanche, Donald Trump a déployé une campagne digitale poussée à l'extrême, qui a brisé les codes et repoussé les limites de la politique « à l'américaine ». Du politiquement correct, aussi.
De Squeezie à Jordan Bardella, en passant par les fans de K-pop, les réseaux sociaux se transforment en ring de boxe où tous les coups sont permis pour influencer les jeunes...
De Squeezie à Jordan Bardella, en passant par les fans de K-pop, les réseaux sociaux se transforment en ring de boxe où tous les coups sont permis pour influencer les jeunes électeurs.
Dans la dernière édition de son classement mondial de la liberté de la presse, l'ONG Reporters sans frontières dresse le bilan d'une profession qui n'en finit plus de perdre...
Dans la dernière édition de son classement mondial de la liberté de la presse, l'ONG Reporters sans frontières dresse le bilan d'une profession qui n'en finit plus de perdre en prestige, comme en marge de manœuvre...
En votant une loi qui vise à bannir TikTok sur son sol, la Chambre des Représentants américaine a déclenché la colère des 170 millions d'utilisateurs que compte le pays et...
En votant une loi qui vise à bannir TikTok sur son sol, la Chambre des Représentants américaine a déclenché la colère des 170 millions d'utilisateurs que compte le pays et allumé un début d'incendie diplomatique avec la Chine...
Dans un souci de rentabilité accrue et de contrôle rigoureux de leur image, de plus en plus de marques s'appuient sur des influenceurs virtuels pour incarner leurs campagnes...
Dans un souci de rentabilité accrue et de contrôle rigoureux de leur image, de plus en plus de marques s'appuient sur des influenceurs virtuels pour incarner leurs campagnes publicitaires et assurer leur promo sur les réseaux sociaux.
Les groupes LinkedIn vont-ils connaître un retour en grâce ? Après les récentes annonces de la plateforme, la question se pose. LinkedIn annonce travailler sur des �...
Les groupes LinkedIn vont-ils connaître un retour en grâce ? Après les récentes annonces de la plateforme, la question se pose. LinkedIn annonce travailler sur des « Groupes Publics ». On vous dit tout.
Avec cinq millions de visiteurs uniques en France selon Médiamétrie et des émissions solidement installées à l'audience croissante, Twitch connaît un pic de popularité qui...
Avec cinq millions de visiteurs uniques en France selon Médiamétrie et des émissions solidement installées à l'audience croissante, Twitch connaît un pic de popularité qui attise la curiosité des annonceurs désireux de capter cette cible aussi jeune que volatile.
Dans le small world du streaming de jeux vidéo, un petit nouveau s'est invité dans la cour des grands que sont Fortnite et Minecraft. Son nom ? Palworld. Le concept ?...
Dans le small world du streaming de jeux vidéo, un petit nouveau s'est invité dans la cour des grands que sont Fortnite et Minecraft. Son nom ? Palworld. Le concept ? Transformer des simili-Pokémon baptisés « Pal » en machines de guerre, pour se lancer à la conquête d'un monde ouvert où tout ce qui est « trooooop mignon » sait manier la kalach... Nintendo voit rouge, Twitch et YouTube en sont déjà gagas !
Story Jungle a créé pour BNP Paribas une content factory à VivaTech pour l'aider à se démarquer et à engager ses audiences sur les réseaux sociaux.
Story Jungle a créé pour BNP Paribas une content factory à VivaTech pour l'aider à se démarquer et à engager ses audiences sur les réseaux sociaux.
Aussi attendues que celles du Super Bowl, les pubs de Noël sont une institution dans les pays anglo-saxons, où les grosses marques ne lésinent jamais sur les moyens...
Aussi attendues que celles du Super Bowl, les pubs de Noël sont une institution dans les pays anglo-saxons, où les grosses marques ne lésinent jamais sur les moyens. Un peu moins en France, certes, même si les « superproductions » sont de plus en plus nombreuses chaque année et que certaines enseignes nous offrent parfois quelques belles pépites. Un Top 5 à ouvrir au pied du sapin, évidemment.
Un accord qui autorise OpenAI à utiliser librement le travail des journalistes pour entraîner ses futurs robots et permettre au premier d'entre eux, ChatGPT,...
Un accord qui autorise OpenAI à utiliser librement le travail des journalistes pour entraîner ses futurs robots et permettre au premier d'entre eux, ChatGPT, de puiser dans les articles pour optimiser ses réponses.
C'est un média à mi-chemin entre Vice, Konkini et Society que nous avons découvert en 2020 sur TikTok au moment où il se lançait en France. Urbania, vous connaissez ?...
C'est un média à mi-chemin entre Vice, Konkini et Society que nous avons découvert en 2020 sur TikTok au moment où il se lançait en France. Urbania, vous connaissez ? Au Canada, c'est un carton chez les jeunes et ça fait 20 ans que ça dure.
C'était l'un des événements les plus attendus de l'année sur Twitch et, comme prévu, la deuxième édition du GP Explorer de Squeezie a fait péter tous les compteurs !...
C'était l'un des événements les plus attendus de l'année sur Twitch et, comme prévu, la deuxième édition du GP Explorer de Squeezie a fait péter tous les compteurs ! Au grand plaisir des marques partenaires.
Pour se conformer au Digital Services Act européen, qui fait la chasse aux publicités ciblées, Meta pourrait proposer des abonnements payants pour Facebook et Instagram.
Pour se conformer au Digital Services Act européen, qui fait la chasse aux publicités ciblées, Meta pourrait proposer des abonnements payants pour Facebook et Instagram.
Voté en juillet 2022 par l'Union européenne, le Digital Services Act, qui vise à protéger les internautes européens des dérives du numérique,...
Voté en juillet 2022 par l'Union européenne, le Digital Services Act, qui vise à protéger les internautes européens des dérives du numérique, est entré en vigueur ce vendredi 25 août. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs comme pour les annonceurs ? Story Jungle fait le point.
Marronniers du mois de janvier, les papiers « X tendances à suivre cette année » fleurissent un peu partout sur le net. Et notamment en matière de marketing digital...
Marronniers du mois de janvier, les papiers « X tendances à suivre cette année » fleurissent un peu partout sur le net. Et notamment en matière de marketing digital. Sujet qui, chez Story Jungle, nous concerne un tout petit peu... Alors, quelles sont les tendances des tendances pour 2024 ? Réponse en trois points.
Philippe Lamarre est le boss d'Urbania. « Un groupe média et producteur de contenu multiplateforme pour les gens curieux, avec une soif de se divertir et de s'informer »,
Philippe Lamarre est le boss d'Urbania. « Un groupe média et producteur de contenu multiplateforme pour les gens curieux, avec une soif de se divertir et de s'informer »,
J-7 avant le lancement de la Coupe du monde de rugby en France ! Parmi toutes les opérations de communication qui fleurissent un partout autour de l'évènement,...
J-7 avant le lancement de la Coupe du monde de rugby en France ! Parmi toutes les opérations de communication qui fleurissent un partout autour de l'évènement, celle orchestrée par Meta mardi dernier intrigue un peu plus que les autres. Et pour cause, elle marque un essai ambitieux que le mastodonte californien doit maintenant transformer...
« Twitch loves Paris !!! » Imprimé en gros sur des bérets violets qui se vendent comme des petits pains, c'était clairement le slogan du week-end dernier à la porte de Versailles
« Twitch loves Paris !!! » Imprimé en gros sur des bérets violets qui se vendent comme des petits pains, c'était clairement le slogan du week-end dernier à la porte de Versailles
Threads, le « Twitter killer » de Meta est en passe de signer le meilleur démarrage de toute l'histoire pour une application
Threads, le « Twitter killer » de Meta est en passe de signer le meilleur démarrage de toute l'histoire pour une application
Dans ce 6e épisode de Story of Stories, nous décryptons le succès éditorial de Time To Sign Off, TTSO pour les intimes.
Dans ce 6e épisode de Story of Stories, nous décryptons le succès éditorial de Time To Sign Off, TTSO pour les intimes.
Le métier passion consume tout autant qu'il fait vibrer. C'est cette relation ambivalente que décortique Anne-Claire Genthialon dans Le piège du métier passion,...
Le métier passion consume tout autant qu'il fait vibrer. C'est cette relation ambivalente que décortique Anne-Claire Genthialon dans Le piège du métier passion, publié aux éditions Alisio.
Les grands réseaux sociaux sont-ils voués à disparaître ? Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers espaces plus confidentiels.
Les grands réseaux sociaux sont-ils voués à disparaître ? Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers espaces plus confidentiels.
Claire Touzard est celle qui ose. Après avoir brisé le tabou de l'addiction à l'alcool dans le pays où le verre de vin est roi, dans un journal de bord intitulé Sans alcool...
Claire Touzard est celle qui ose. Après avoir brisé le tabou de l'addiction à l'alcool dans le pays où le verre de vin est roi, dans un journal de bord intitulé Sans alcool, elle s'attaque dans Féminin, un roman d'auto-fiction ,au modèle économique de la presse féminine, et dans une plus large mesure au capitalisme.
Mathieu Marmouget a pris les commandes de Mouv', la radio jeune de Radio France, en 2022. Sous son impulsion, l'antenne est repensée avec l'idée de célébrer la créativité...
Mathieu Marmouget a pris les commandes de Mouv', la radio jeune de Radio France, en 2022. Sous son impulsion, l'antenne est repensée avec l'idée de célébrer la créativité des jeunes... et capter leur attention dans les réseaux sociaux. Et sur ce point, c'est un vrai succès. Il est l'invité de ce 12ème épisode de Story of Stories.
En cause, la dernière version du texte, qui apporte une légère modification sur un point très précis : celui relatif à l'usage de spywares par les gouvernements.
En cause, la dernière version du texte, qui apporte une légère modification sur un point très précis : celui relatif à l'usage de spywares par les gouvernements.
« Trop de contenu tue le contenu ? » Une question qui turlupine de plus en plus les agences de marketing digital
« Trop de contenu tue le contenu ? » Une question qui turlupine de plus en plus les agences de marketing digital
S'il est bien un sujet qui ne supporte pas l'eau tiède, c'est le climat. La preuve : quand il s'agit de la crise climatique, entreprises et presse communiquent sans cesse.....
S'il est bien un sujet qui ne supporte pas l'eau tiède, c'est le climat. La preuve : quand il s'agit de la crise climatique, entreprises et presse communiquent sans cesse... sans jamais convaincre totalement. Le 21e Cahier des Tendances de Méta-Media s'est penché sur le cas particulier des médias : face à la crise climatique, font-ils vraiment le job ?
Bienvenue dans l'ère des trolls ! En décidant de revoir complètement sa politique de modération des contenus, Mark Zuckerberg a entériné l'allégeance des réseaux sociaux...
Bienvenue dans l'ère des trolls ! En décidant de revoir complètement sa politique de modération des contenus, Mark Zuckerberg a entériné l'allégeance des réseaux sociaux à Donald Trump et déclenché un tsunami chez les annonceurs.
110 000 viewers en direct pour une émission de 2h. C'est le tour de force réussi mardi dernier par Zen, un talk-show diffusé sur Twitch.
110 000 viewers en direct pour une émission de 2h. C'est le tour de force réussi mardi dernier par Zen, un talk-show diffusé sur Twitch.
Il est le cofondateur d'Axios. Il est l'auteur des newsletters quotidiennes Axios AM et Axios PM, et il couvre les nouvelles les plus importantes de la journée
Il est le cofondateur d'Axios. Il est l'auteur des newsletters quotidiennes Axios AM et Axios PM, et il couvre les nouvelles les plus importantes de la journée
Auteur du livre Les 100 expressions à éviter au bureau & ailleurs, il anime également le Talk Décideurs du Figaro. Quentin Périnel est une des Top Voices de LinkedIn
Auteur du livre Les 100 expressions à éviter au bureau & ailleurs, il anime également le Talk Décideurs du Figaro. Quentin Périnel est une des Top Voices de LinkedIn
Tusar Barik, qui travaille chez LinkedIn depuis 5 ans, est spécialisé dans le marketing digital, la publicité, le branding et les réseaux sociaux.
Tusar Barik, qui travaille chez LinkedIn depuis 5 ans, est spécialisé dans le marketing digital, la publicité, le branding et les réseaux sociaux.
Les jeunes streamers s'imposent sur la plateforme de streaming, par le biais d'une stratégie média puissante.
Les jeunes streamers s'imposent sur la plateforme de streaming, par le biais d'une stratégie média puissante.
« Il est peu probable que ChatGPT signe la fin des copywriters. Bien que ChatGPT puisse générer du contenu de manière automatisée, il ne peut pas remplacer la créativité...
« Il est peu probable que ChatGPT signe la fin des copywriters. Bien que ChatGPT puisse générer du contenu de manière automatisée, il ne peut pas remplacer la créativité, la sensibilité, l'expérience et la compréhension humaine des copywriters. »
2022 marque un tournant pour LinkedIn, qui s'est invité dans le Top 3 des réseaux sociaux plébiscités par les marques françaises. Et qui ne compte pas s'arrêter là...
2022 marque un tournant pour LinkedIn, qui s'est invité dans le Top 3 des réseaux sociaux plébiscités par les marques françaises. Et qui ne compte pas s'arrêter là...
Suivez-nous
|