- Communication du CEO
- Formation LinkedIn
- Live LinkedIn
- Leader Advocacy
- Newsletter LinkedIn
- Personal Branding / Marque personnelle
- Stratégie LinkedIn

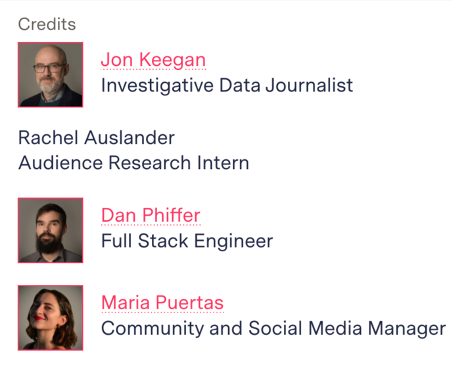
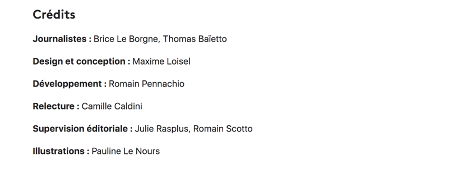

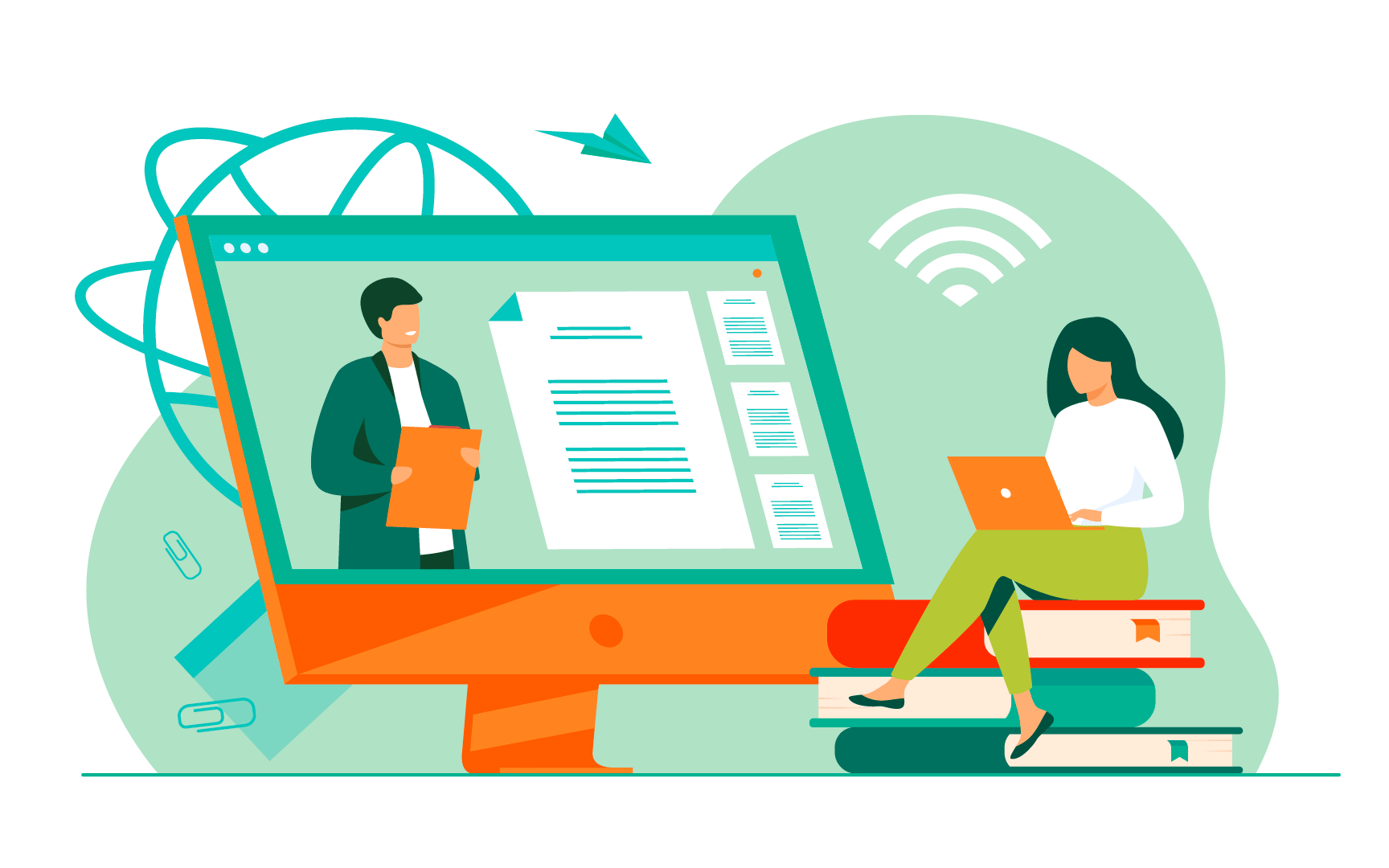
Ne ratez pas nos évènements, webinaires en ligne ou petits déjeuner bien physiques
>> Recevez nos invitations aux webinairesCette année, Story Jungle a de nouveau fait le voyage jusqu'à Sciences Po Paris pour assister à la conférence 2022 des Nouvelles Pratiques du Journalisme...
Cette année, Story Jungle a de nouveau fait le voyage jusqu'à Sciences Po Paris pour assister à la conférence 2022 des Nouvelles Pratiques du Journalisme. Le thème de cette 14e édition ? Informer à l'ère de TikTok.
Au sein du CELSA, le 26 janvier dernier, a eu lieu la 13e édition de la Conférence nationale des métiers du journalisme. Le thème de cette année : l'information à l'ère...
Au sein du CELSA, le 26 janvier dernier, a eu lieu la 13e édition de la Conférence nationale des métiers du journalisme. Le thème de cette année : l'information à l'ère de l'influence et du branding sur les réseaux. Story Jungle fait un récap' de la journée.
Depuis 2013, il travaille dans le journalisme numérique et le développement de l'audience. Francesco Zaffarano est passionné par l'univers des médias et de l'innovation...
Depuis 2013, il travaille dans le journalisme numérique et le développement de l'audience. Francesco Zaffarano est passionné par l'univers des médias et de l'innovation. Il a été Instagram Producer chez The Economist, Social Media Editor chez Telegraph, Assistant video producer chez Vice Media ou encore journaliste au Corriere della Serra.
Il aime la littérature avant le journalisme. Et pourtant, depuis un an et demi, il est à la tête du média d'extrême gauche Blast. Frappé par �...
Il aime la littérature avant le journalisme. Et pourtant, depuis un an et demi, il est à la tête du média d'extrême gauche Blast. Frappé par « la violence de l'État macronien », Denis Robert a décidé de reprendre le flambeau de l'info.
Comme chaque année, le Reuters Institute déroule les tendances à venir pour l'industrie des médias. S'appuyant sur le témoignage de 303 acteurs – rédacteurs en chef,...
Comme chaque année, le Reuters Institute déroule les tendances à venir pour l'industrie des médias. S'appuyant sur le témoignage de 303 acteurs – rédacteurs en chef, directeurs généraux, responsables du numérique et de l'innovation – de 53 pays, l'étude s'interroge sur la viabilité des médias, dans un contexte plus qu'incertain : inflation galopante, lassitude des lecteurs face à une couverture médiatique anxiogène, désintérêt des plateformes sociales pour l'actu, retrait des annonceurs, hausse du coût du papier.
Les différentes études publiées par Médiamétrie le confirment : les smartphones continuent de booster la consommation de formats audio dans l'Hexagone,...
Les différentes études publiées par Médiamétrie le confirment : les smartphones continuent de booster la consommation de formats audio dans l'Hexagone, où plus de la moitié des contenus sont désormais écoutés sur des supports numériques...
Pour ce deuxième numéro, Story Jungle accueille Joël Ronez, président et cofondateur de Binge Audio, un des premiers studios en France de podcast natif...
Pour ce deuxième numéro, Story Jungle accueille Joël Ronez, président et cofondateur de Binge Audio, un des premiers studios en France de podcast natif. Ce vétéran des médias, passé par le pôle numérique d'Arte et ex-directeur des nouveaux médias de Radio France, revient sur les coulisses d'un projet né fin 2016 et haut-parleur des causes sociétales.
C'est un « voyage au bout de l'info » que propose l'entrepreneur, et auteur, journaliste spécialisée dans les usages de l'intelligence artificielle Benoit Rapha�...
C'est un « voyage au bout de l'info » que propose l'entrepreneur, et auteur, journaliste spécialisée dans les usages de l'intelligence artificielle Benoit Raphaël dans son livre « Information : l'indigestion », un manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info, publiée aux éditions Eyrolles.
En juillet dernier, Dassault Systèmes, une marque B2B s'il en est, se lançait sur TikTok. 7 mois plus tard, la marque compte 63 000 abonnés et plus d'un millions de likes,...
En juillet dernier, Dassault Systèmes, une marque B2B s'il en est, se lançait sur TikTok. 7 mois plus tard, la marque compte 63 000 abonnés et plus d'un millions de likes, un post à plus de 7 millions de vues et plusieurs flirtant avec le million.
Pour sa cinquième édition, le festival Médias en Seine, organisé par Les Échos, Le Parisien et Franceinfo, a réuni près de 6000 participants et 200 intervenants français...
Pour sa cinquième édition, le festival Médias en Seine, organisé par Les Échos, Le Parisien et Franceinfo, a réuni près de 6000 participants et 200 intervenants français et internationaux, autour d'un thème très large : «Médias, quelles responsabilités, quelles réponses par temps de crise?» Retour choisi sur une riche édition.
En votant une loi visant à bannir TikTok si l'application reste sous pavillon chinois, le gouvernement américain a mis ses menaces à exécution...
En votant une loi visant à bannir TikTok si l'application reste sous pavillon chinois, le gouvernement américain a mis ses menaces à exécution. Peut-il aller au bout et faire tomber le couperet ? Plusieurs scénarios se dessinent...
En votant une loi qui vise à bannir TikTok sur son sol, la Chambre des Représentants américaine a déclenché la colère des 170 millions d'utilisateurs que compte le pays et...
En votant une loi qui vise à bannir TikTok sur son sol, la Chambre des Représentants américaine a déclenché la colère des 170 millions d'utilisateurs que compte le pays et allumé un début d'incendie diplomatique avec la Chine...
Dans ce 6e épisode de Story of Stories, nous décryptons le succès éditorial de Time To Sign Off, TTSO pour les intimes.
Dans ce 6e épisode de Story of Stories, nous décryptons le succès éditorial de Time To Sign Off, TTSO pour les intimes.
L'application ChatGPT représente-t-il une menace pour l'univers de la communication et des médias ? Story Jungle fait le point sur cette fascinante intelligence artificielle...
L'application ChatGPT représente-t-il une menace pour l'univers de la communication et des médias ? Story Jungle fait le point sur cette fascinante intelligence artificielle.
Après Twitter, Meta vient d'officialiser le plus important plan social en valeur absolue dans cette industrie ces dernières années.
Après Twitter, Meta vient d'officialiser le plus important plan social en valeur absolue dans cette industrie ces dernières années.
Le Paris Podcast Festival a pris fin ce dimanche 23 octobre, après quatre jours de rencontres. 300 intervenants, 80 événements : l'événement a été riche,...
Le Paris Podcast Festival a pris fin ce dimanche 23 octobre, après quatre jours de rencontres. 300 intervenants, 80 événements : l'événement a été riche, réunissant plus de 8 000 visiteurs à la Gaîté Lyrique, à Paris. Nina Cohen, directrice du Paris Podcast Festival, fait le point sur cette cinquième édition, placée sous le signe de la « puissance de la douceur ». Interview.
Gilles Tanguy a fondé L'Informé avec l'ambition de faire all-in sur l'information exclusive. L'Informé est « un média d'investigation économique libre, factuel et sans pub...
Gilles Tanguy a fondé L'Informé avec l'ambition de faire all-in sur l'information exclusive. L'Informé est « un média d'investigation économique libre, factuel et sans pub », comme le dit la baseline. Il publie 4 à 5 scoops par jour, soit déjà plus de 2 500 depuis le lancement en octobre 2022.
Steffen Hedebrandt est le cofondateur et actuel Chief Marketing Officer de Dreamdata.
Steffen Hedebrandt est le cofondateur et actuel Chief Marketing Officer de Dreamdata.
C'est un média à mi-chemin entre Vice, Konkini et Society que nous avons découvert en 2020 sur TikTok au moment où il se lançait en France. Urbania, vous connaissez ?...
C'est un média à mi-chemin entre Vice, Konkini et Society que nous avons découvert en 2020 sur TikTok au moment où il se lançait en France. Urbania, vous connaissez ? Au Canada, c'est un carton chez les jeunes et ça fait 20 ans que ça dure.
La défiance en Occident ne fait que s'accentuer des deux côtés de l'Atlantique. En Europe, c'est la Commission européenne qui dégaine la première,...
La défiance en Occident ne fait que s'accentuer des deux côtés de l'Atlantique. En Europe, c'est la Commission européenne qui dégaine la première, en annonçant la semaine dernière que son personnel avait jusqu'au 15 mars pour désinstaller l'application de ses appareils professionnels.
TikTok, « Créateur d'une véritable addiction » chez les jeunes serait « le premier perturbateur (psychologique) chez les enfants et les adolescents
TikTok, « Créateur d'une véritable addiction » chez les jeunes serait « le premier perturbateur (psychologique) chez les enfants et les adolescents
Pour approfondir le sujet DeepSeek, nous vous recommandons le dernier épisode de Silicon Carne, le podcast présenté par Carlos Diaz en direct de San Francisco.
Pour approfondir le sujet DeepSeek, nous vous recommandons le dernier épisode de Silicon Carne, le podcast présenté par Carlos Diaz en direct de San Francisco.
LinkedIn lance la Podcast Academy pour aider la nouvelle génération de podcasteurs à décoller sur la plateforme.
LinkedIn lance la Podcast Academy pour aider la nouvelle génération de podcasteurs à décoller sur la plateforme.
C'est un enseignement de l'étude menée par LinkedIn et Bain & Company et présentée au B2Believe 2024. La Gen Z est de plus en plus présente sur LinkedIn,...
C'est un enseignement de l'étude menée par LinkedIn et Bain & Company et présentée au B2Believe 2024. La Gen Z est de plus en plus présente sur LinkedIn, avec ses codes bien à elle inspirés de son comportement sur TikTok !
LinkedIn multiplie les idées pour promouvoir les contenus vidéo sur sa plateforme ... et s'inspire de TikTok dans la mise en avant de ce format de plus en plus populaire auprès...
LinkedIn multiplie les idées pour promouvoir les contenus vidéo sur sa plateforme ... et s'inspire de TikTok dans la mise en avant de ce format de plus en plus populaire auprès de ses utilisateurs.
L'intégration galopante de l'intelligence artificielle dans les moteurs de recherche devrait changer les règles du « search game » en profondeur. Jusqu'à quel point ?
L'intégration galopante de l'intelligence artificielle dans les moteurs de recherche devrait changer les règles du « search game » en profondeur. Jusqu'à quel point ?
Et si LinkedIn prenait, elle aussi, le train de la vidéo courte en marche ? C'est ce que laisse penser cette nouvelle fonctionnalité annoncée par certains experts social media...
Et si LinkedIn prenait, elle aussi, le train de la vidéo courte en marche ? C'est ce que laisse penser cette nouvelle fonctionnalité annoncée par certains experts social media de la plateforme qui testent actuellement un feed vidéo ressemblant à celui de TikTok
Pour les médias comme pour les marques, la newsletter s'impose comme un canal hautement stratégique, presque prioritaire, qui se conjugue au futur et permet de toucher une audience...
Pour les médias comme pour les marques, la newsletter s'impose comme un canal hautement stratégique, presque prioritaire, qui se conjugue au futur et permet de toucher une audience plus qualitative. Plus engagée, aussi.
LinkedIn dévoile une nouvelle fonctionnalité permettant de sponsoriser les articles LinkedIn publiés sur les pages entreprises.
LinkedIn dévoile une nouvelle fonctionnalité permettant de sponsoriser les articles LinkedIn publiés sur les pages entreprises.
Un accord qui autorise OpenAI à utiliser librement le travail des journalistes pour entraîner ses futurs robots et permettre au premier d'entre eux, ChatGPT,...
Un accord qui autorise OpenAI à utiliser librement le travail des journalistes pour entraîner ses futurs robots et permettre au premier d'entre eux, ChatGPT, de puiser dans les articles pour optimiser ses réponses.
Même s'il est encore loin des résultats obtenus par Instagram, TikTok s'impose petit à petit comme un outil marketing particulièrement utile pour les agences comme pour les...
Même s'il est encore loin des résultats obtenus par Instagram, TikTok s'impose petit à petit comme un outil marketing particulièrement utile pour les agences comme pour les annonceurs. Grâce, notamment, au lancement de TikTok Shop.
Le 13 juillet dernier. Par la voix de Duncan Crabtree-Ireland, directeur exécutif du SAG-AFTRA qui représente 160 000 professionnels de l'industrie cinématographique américaine...
Le 13 juillet dernier. Par la voix de Duncan Crabtree-Ireland, directeur exécutif du SAG-AFTRA qui représente 160 000 professionnels de l'industrie cinématographique américaine, les acteurs rejoignaient officiellement le mouvement de grève lancé par les scénaristes
La guerre déclenchée par le Hamas en Israël a entraîné une vague de désinformation et de contenus frauduleux – générés notamment par l'IA –,...
La guerre déclenchée par le Hamas en Israël a entraîné une vague de désinformation et de contenus frauduleux – générés notamment par l'IA –, poussant l'Union européenne à accentuer la pression mise par le DSA sur les grandes plateformes sociales.
En cause, la dernière version du texte, qui apporte une légère modification sur un point très précis : celui relatif à l'usage de spywares par les gouvernements.
En cause, la dernière version du texte, qui apporte une légère modification sur un point très précis : celui relatif à l'usage de spywares par les gouvernements.
S'il est bien un sujet qui ne supporte pas l'eau tiède, c'est le climat. La preuve : quand il s'agit de la crise climatique, entreprises et presse communiquent sans cesse.....
S'il est bien un sujet qui ne supporte pas l'eau tiède, c'est le climat. La preuve : quand il s'agit de la crise climatique, entreprises et presse communiquent sans cesse... sans jamais convaincre totalement. Le 21e Cahier des Tendances de Méta-Media s'est penché sur le cas particulier des médias : face à la crise climatique, font-ils vraiment le job ?
De Squeezie à Jordan Bardella, en passant par les fans de K-pop, les réseaux sociaux se transforment en ring de boxe où tous les coups sont permis pour influencer les jeunes...
De Squeezie à Jordan Bardella, en passant par les fans de K-pop, les réseaux sociaux se transforment en ring de boxe où tous les coups sont permis pour influencer les jeunes électeurs.
Dans la dernière édition de son classement mondial de la liberté de la presse, l'ONG Reporters sans frontières dresse le bilan d'une profession qui n'en finit plus de perdre...
Dans la dernière édition de son classement mondial de la liberté de la presse, l'ONG Reporters sans frontières dresse le bilan d'une profession qui n'en finit plus de perdre en prestige, comme en marge de manœuvre...
Philippe Lamarre est le boss d'Urbania. « Un groupe média et producteur de contenu multiplateforme pour les gens curieux, avec une soif de se divertir et de s'informer »,
Philippe Lamarre est le boss d'Urbania. « Un groupe média et producteur de contenu multiplateforme pour les gens curieux, avec une soif de se divertir et de s'informer »,
Marion Wyss, rédactrice en chef de The Audiencers et CMO de la startup Poool, a conçu une stratégie de contenu en forme de masterclass pour tout adepte du marketing de contenu...
Marion Wyss, rédactrice en chef de The Audiencers et CMO de la startup Poool, a conçu une stratégie de contenu en forme de masterclass pour tout adepte du marketing de contenu. Elle est l'invitée de Story of stories, le podcast qui décrypte l'histoire derrière un succès éditorial.
Story Jungle est une agence indépendante, leader du Content marketing à destination des cibles premium et B2B et un média dédié aux nouvelles narrations.
Story Jungle est une agence indépendante, leader du Content marketing à destination des cibles premium et B2B et un média dédié aux nouvelles narrations.
Le site d'information BuzzFeed News ferme ses portes. C'est ce qu'a annoncé la direction du groupe de divertissement BuzzFeed, jeudi 20 avril.
Le site d'information BuzzFeed News ferme ses portes. C'est ce qu'a annoncé la direction du groupe de divertissement BuzzFeed, jeudi 20 avril.
Les grands réseaux sociaux sont-ils voués à disparaître ? Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers espaces plus confidentiels.
Les grands réseaux sociaux sont-ils voués à disparaître ? Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers espaces plus confidentiels.
Auteur du livre Les 100 expressions à éviter au bureau & ailleurs, il anime également le Talk Décideurs du Figaro. Quentin Périnel est une des Top Voices de LinkedIn
Auteur du livre Les 100 expressions à éviter au bureau & ailleurs, il anime également le Talk Décideurs du Figaro. Quentin Périnel est une des Top Voices de LinkedIn
Les jeunes streamers s'imposent sur la plateforme de streaming, par le biais d'une stratégie média puissante.
Les jeunes streamers s'imposent sur la plateforme de streaming, par le biais d'une stratégie média puissante.
Quels sont les secrets des experts de la com' ? Que font-ils derrière leur ordinateur ? Story Jungle propose une rencontre de ceux qui sont au cœur des stratégies de contenus...
Quels sont les secrets des experts de la com' ? Que font-ils derrière leur ordinateur ? Story Jungle propose une rencontre de ceux qui sont au cœur des stratégies de contenus ! Retrouvez notre invitée de notre format « Tu bosses sur quoi ? »: Aline Geffroy, Global Social Media Director chez Saint-Gobain
C'est un touche-à-tout, qui entend redorer le blason des influenceurs. Il a organisé les For You Awards, une cérémonie qui récompense les nouveaux talents venus de TikTok...
C'est un touche-à-tout, qui entend redorer le blason des influenceurs. Il a organisé les For You Awards, une cérémonie qui récompense les nouveaux talents venus de TikTok, YouTube, Instagram.
Mélissa Lambert, Social Media Manager chez Welcome to the Jungle, lève le voile sur un métier parfois compliqué à appréhender : elle y évoque ses tâches quotidiennes,...
Mélissa Lambert, Social Media Manager chez Welcome to the Jungle, lève le voile sur un métier parfois compliqué à appréhender : elle y évoque ses tâches quotidiennes, ses insights sur Facebook, Twitter, LinkedIn et TikTok.
Comme chaque année, le festival Médias en Seine, organisé par le groupe les Echos-Le Parisien et France Info, rassemble les têtes du secteur médiatique...
Comme chaque année, le festival Médias en Seine, organisé par le groupe les Echos-Le Parisien et France Info, rassemble les têtes du secteur médiatique. On tente de prendre le pouls du secteur. Le but affiché de chaque édition : "répondre aux enjeux du monde de demain".
Le cours de l'action de Meta s'effondre. Mark Zuckerberg reste serein. Les actionnaires moins.
Le cours de l'action de Meta s'effondre. Mark Zuckerberg reste serein. Les actionnaires moins.
Quel est le secret des contenus qui engagent ? Comment capter l'attention dans un univers bruyant ? Story Jungle lance Story of Stories, un podcast qui décrypte l'histoire derrière...
Quel est le secret des contenus qui engagent ? Comment capter l'attention dans un univers bruyant ? Story Jungle lance Story of Stories, un podcast qui décrypte l'histoire derrière un succès éditorial. Notre ambition avec ce podcast ? Donner des armes à tous ceux qui, comme nous, tentent de mener la guerre contre l'eau tiède. Et pour ce premier numéro, focus sur le média de Yoann Lopez : Snowball, une newsletter gratuite et payante dédiée aux finances personnelles.
Suivez-nous
|