- Communication du CEO
- Formation LinkedIn
- Live LinkedIn
- Leader Advocacy
- Newsletter LinkedIn
- Personal Branding / Marque personnelle
- Stratégie LinkedIn


«Nous avons besoin de tels lieux pour retisser du lien avec le public, et par la même occasion faire descendre les journalistes du piédestal dans lequel ils se complaisent»
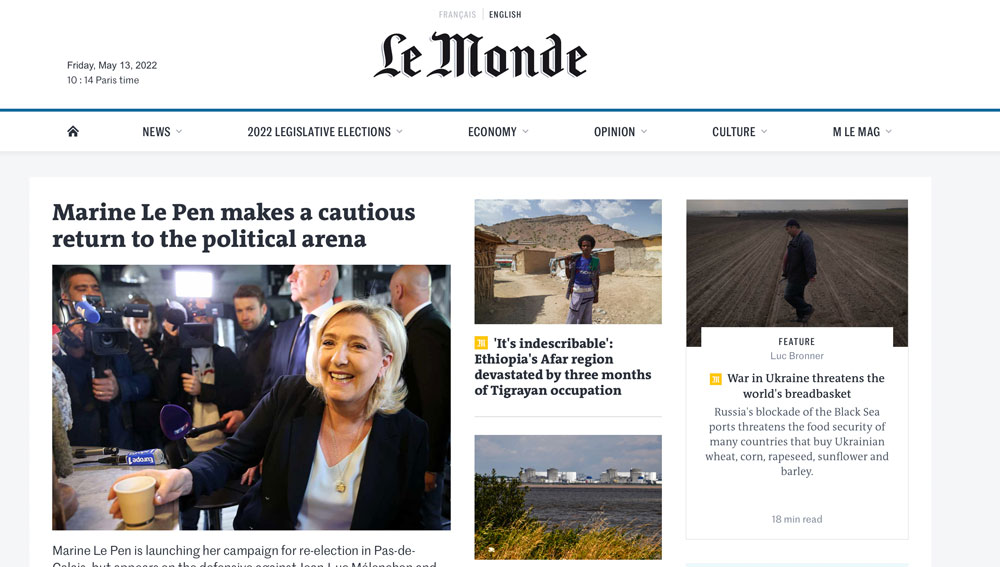
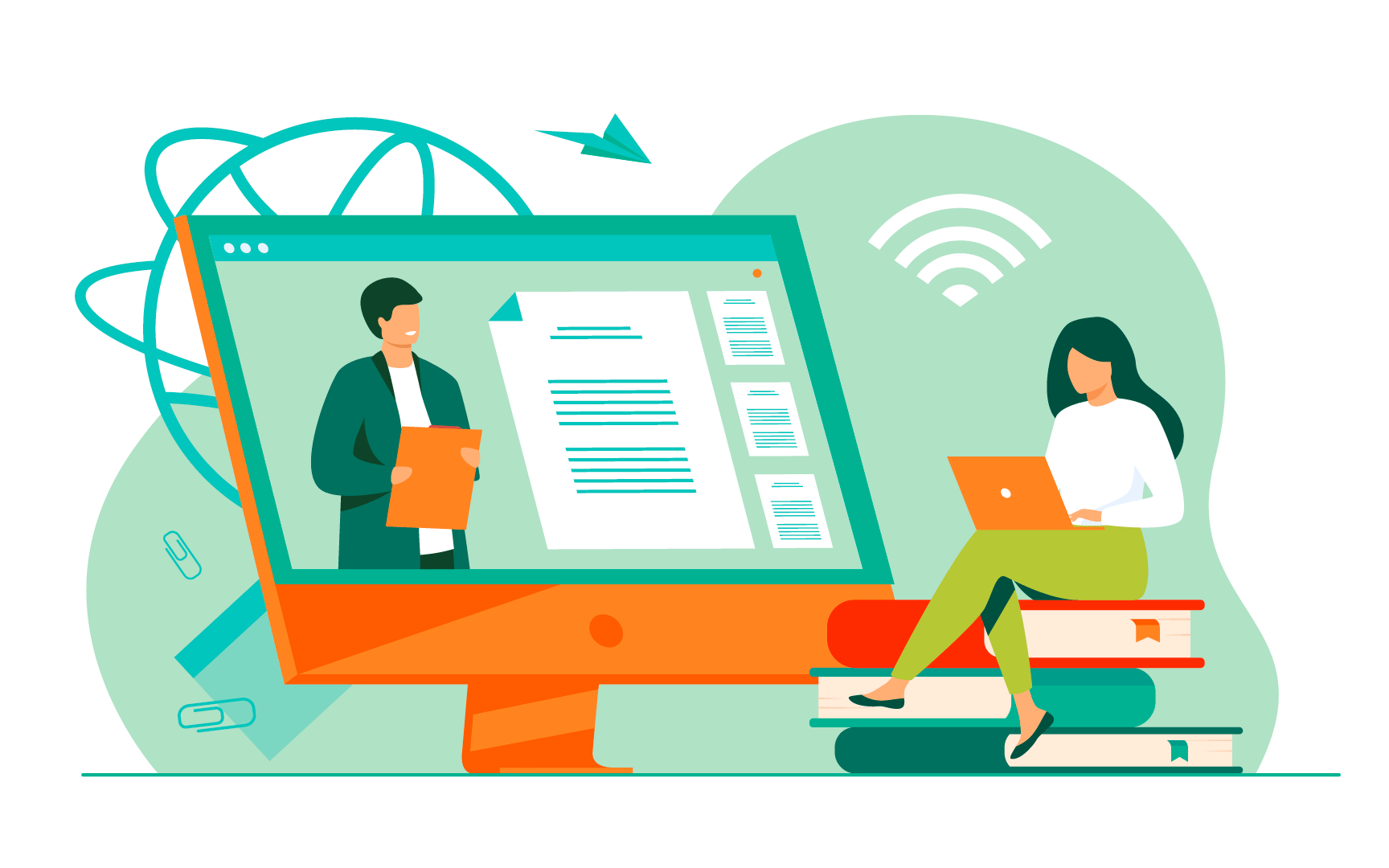
Ne ratez pas nos évènements, webinaires en ligne ou petits déjeuner bien physiques
>> Recevez nos invitations aux webinairesIl aime la littérature avant le journalisme. Et pourtant, depuis un an et demi, il est à la tête du média d'extrême gauche Blast. Frappé par �...
Il aime la littérature avant le journalisme. Et pourtant, depuis un an et demi, il est à la tête du média d'extrême gauche Blast. Frappé par « la violence de l'État macronien », Denis Robert a décidé de reprendre le flambeau de l'info.
Le lien entre les médias et le public s'effiloche. L'intérêt pour l'information est en baisse, la « news avoidance » en hausse et la confiance loin d'être acquise...
Le lien entre les médias et le public s'effiloche. L'intérêt pour l'information est en baisse, la « news avoidance » en hausse et la confiance loin d'être acquise. C'est l'une des conclusions du Digital News Report du Reuters Institute, publié ce 15 juin.
Selon Forbes, il s'agit de « l'expérience médiatique la plus originale de l'année ». Sous la direction de Casey Newton, huit journalistes tech indépendants ont lancé leur...
Selon Forbes, il s'agit de « l'expérience médiatique la plus originale de l'année ». Sous la direction de Casey Newton, huit journalistes tech indépendants ont lancé leur propre salle de rédaction virtuelle sur Discord, plateforme fondée sur l'audio très prisée des gamers, dont l'usage s'est diversifié avec la pandémie. Intitulé Sidechannel, le serveur Discord est un embryon de rédaction. Sur l'appli, les abonnés peuvent discuter entre eux, assistent en direct à des interviews exclusives. Ce Slack amélioré a été lancé en parallèle des newsletters payantes de chacun des créateurs. Ryan Broderick, journaliste spécialisé dans la culture web et tête pensante de Sidechannel, évoque avec nous l'origine du projet.
Au sein du CELSA, le 26 janvier dernier, a eu lieu la 13e édition de la Conférence nationale des métiers du journalisme. Le thème de cette année : l'information à l'ère...
Au sein du CELSA, le 26 janvier dernier, a eu lieu la 13e édition de la Conférence nationale des métiers du journalisme. Le thème de cette année : l'information à l'ère de l'influence et du branding sur les réseaux. Story Jungle fait un récap' de la journée.
Il possède le Sun, le Wall Street Journal, Fox News... : à l'âge de 91 ans, Rupert Murdoch reste l'un des hommes les plus influents de la planète et... �...
Il possède le Sun, le Wall Street Journal, Fox News... : à l'âge de 91 ans, Rupert Murdoch reste l'un des hommes les plus influents de la planète et... « un cancer pour la démocratie ». L'historien David Colon lui consacre une biographie prenante, sur fond de concentration des médias : Rupert Murdoch, l'empereur des médias qui manipule le monde, publiée aux éditions Tallandier.
Une application gamifiée et interactive, avec des news du jour, développée spécialement pour la génération Z. Tel est le pari de Splash, l'application imaginée par Maxime...
Une application gamifiée et interactive, avec des news du jour, développée spécialement pour la génération Z. Tel est le pari de Splash, l'application imaginée par Maxime Voisin et Hugo Travers, de la chaîne YouTube HugoDécrypte. Disponible sur l'App Store et le Google Store, elle vise à réconcilier les jeunes avec l'information en leur proposant un récap clair, condensé et personnalisé, sous la forme de fiches et de stories vidéo. Interview avec Maxime Voisin sur cette application très moderne.
Gilles Tanguy a fondé L'Informé avec l'ambition de faire all-in sur l'information exclusive. L'Informé est « un média d'investigation économique libre, factuel et sans pub...
Gilles Tanguy a fondé L'Informé avec l'ambition de faire all-in sur l'information exclusive. L'Informé est « un média d'investigation économique libre, factuel et sans pub », comme le dit la baseline. Il publie 4 à 5 scoops par jour, soit déjà plus de 2 500 depuis le lancement en octobre 2022.
C'est un « voyage au bout de l'info » que propose l'entrepreneur, et auteur, journaliste spécialisée dans les usages de l'intelligence artificielle Benoit Rapha�...
C'est un « voyage au bout de l'info » que propose l'entrepreneur, et auteur, journaliste spécialisée dans les usages de l'intelligence artificielle Benoit Raphaël dans son livre « Information : l'indigestion », un manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info, publiée aux éditions Eyrolles.
Plus d'un Français sur deux souffre de fatigue informationnelle. Surtout les plus jeunes et les plus connectés. C'est le constat dressé par une étude de l'L'ObSoCo,...
Plus d'un Français sur deux souffre de fatigue informationnelle. Surtout les plus jeunes et les plus connectés. C'est le constat dressé par une étude de l'L'ObSoCo, la Fondation Jean-Jaurès et ARTE.
Les différentes études publiées par Médiamétrie le confirment : les smartphones continuent de booster la consommation de formats audio dans l'Hexagone,...
Les différentes études publiées par Médiamétrie le confirment : les smartphones continuent de booster la consommation de formats audio dans l'Hexagone, où plus de la moitié des contenus sont désormais écoutés sur des supports numériques...
En cause, la dernière version du texte, qui apporte une légère modification sur un point très précis : celui relatif à l'usage de spywares par les gouvernements.
En cause, la dernière version du texte, qui apporte une légère modification sur un point très précis : celui relatif à l'usage de spywares par les gouvernements.
Comme chaque année, le Reuters Institute for the Study of Journalism publie son rapport sur la consommation de l'information dans le monde. S'appuyant sur un panel de 46 pays...
Comme chaque année, le Reuters Institute for the Study of Journalism publie son rapport sur la consommation de l'information dans le monde. S'appuyant sur un panel de 46 pays, l'étude de 164 pages fait le point sur les liens entre les médias et les consommateurs. Et bonne nouvelle, 44% des sondés estiment faire confiance aux médias, soit six points de plus que l'année dernière. On a échangé sur les principaux points du Digital News Report avec deux instigateurs de l'étude : Rasmus Nielsen, directeur du Reuters Institute et Nic Newman, Senior Research Associate au Reuters Institute.
S'il est bien un sujet qui ne supporte pas l'eau tiède, c'est le climat. La preuve : quand il s'agit de la crise climatique, entreprises et presse communiquent sans cesse.....
S'il est bien un sujet qui ne supporte pas l'eau tiède, c'est le climat. La preuve : quand il s'agit de la crise climatique, entreprises et presse communiquent sans cesse... sans jamais convaincre totalement. Le 21e Cahier des Tendances de Méta-Media s'est penché sur le cas particulier des médias : face à la crise climatique, font-ils vraiment le job ?
Pour sa cinquième édition, le festival Médias en Seine, organisé par Les Échos, Le Parisien et Franceinfo, a réuni près de 6000 participants et 200 intervenants français...
Pour sa cinquième édition, le festival Médias en Seine, organisé par Les Échos, Le Parisien et Franceinfo, a réuni près de 6000 participants et 200 intervenants français et internationaux, autour d'un thème très large : «Médias, quelles responsabilités, quelles réponses par temps de crise?» Retour choisi sur une riche édition.
La 35e édition du Baromètre de confiance dans les médias Kantar-Onepoint pour La Croix, publiée jeudi 20 janvier, montre un tableau « peu flatteur pour la presse »,...
La 35e édition du Baromètre de confiance dans les médias Kantar-Onepoint pour La Croix, publiée jeudi 20 janvier, montre un tableau « peu flatteur pour la presse », comme l'écrit la journaliste Anne Ponce. Intérêt pour l'actu en baisse, sujets répétitifs et anxiogènes trop mis en avant, crédibilité de la presse en berne, rupture entre la jeunesse française et les médias dits traditionnels...
« Les médias vont un peu mieux que ce que l'on pourrait croire », affirme David Barroux, rédacteur en chef des Echos, en guise de préambule à la 4e édition de Médias en...
« Les médias vont un peu mieux que ce que l'on pourrait croire », affirme David Barroux, rédacteur en chef des Echos, en guise de préambule à la 4e édition de Médias en Seine, organisée ce mardi 12 octobre par Les Echos et Franceinfo.
Le mensuel Science et Vie, propriété de Reworld Media (Biba, Grazia...), s'est vidé peu à peu de sa rédaction après s'être transformé en usine à contenus...
Le mensuel Science et Vie, propriété de Reworld Media (Biba, Grazia...), s'est vidé peu à peu de sa rédaction après s'être transformé en usine à contenus. Les anciens journalistes font volte-face et créent leur propre magazine d'actualité scientifique à paraître le 26 juin, baptisé Epsiloon. Hervé Poirier, ex-rédacteur en chef de Science et Vie, revient sur ce nouveau projet dont il est à l'origine.
12 utopies nécessaires, 12 magazines du futur reliés en un seul. Telle est la promesse initiale de "Big Bang", le petit nouveau de So Press, une revue de 340 pages écrite par...
12 utopies nécessaires, 12 magazines du futur reliés en un seul. Telle est la promesse initiale de "Big Bang", le petit nouveau de So Press, une revue de 340 pages écrite par une armada de plumes - 29 hommes et 9 femmes - sortie mi-avril dans les kiosques. "Big Bang, c'est le viagra du cerveau", nous promet-on... Entretien avec Franck Annese, le big boss de So Press.
Depuis le début du confinement, les recettes publicitaires connaissent une chute vertigineuse. Afin d'aider les médias à sortir la tête de l'eau, Aurore Bergé,...
Depuis le début du confinement, les recettes publicitaires connaissent une chute vertigineuse. Afin d'aider les médias à sortir la tête de l'eau, Aurore Bergé, rapporteure du projet de loi sur l'audiovisuel, plaide pour la mise en place d'un crédit d'impôt sur les dépenses de communication. Bertrand Beaudichon, CEO d'Initiative, agence média du groupe IPG Mediabrands, et ancien président de l'Udecam, réagit à la proposition pour Story Jungle et évoque les nouvelles dynamiques d'un secteur ébranlé par une crise sans précédent.
Dans la dernière édition de son classement mondial de la liberté de la presse, l'ONG Reporters sans frontières dresse le bilan d'une profession qui n'en finit plus de perdre...
Dans la dernière édition de son classement mondial de la liberté de la presse, l'ONG Reporters sans frontières dresse le bilan d'une profession qui n'en finit plus de perdre en prestige, comme en marge de manœuvre...
Un accord qui autorise OpenAI à utiliser librement le travail des journalistes pour entraîner ses futurs robots et permettre au premier d'entre eux, ChatGPT,...
Un accord qui autorise OpenAI à utiliser librement le travail des journalistes pour entraîner ses futurs robots et permettre au premier d'entre eux, ChatGPT, de puiser dans les articles pour optimiser ses réponses.
Philippe Lamarre est le boss d'Urbania. « Un groupe média et producteur de contenu multiplateforme pour les gens curieux, avec une soif de se divertir et de s'informer »,
Philippe Lamarre est le boss d'Urbania. « Un groupe média et producteur de contenu multiplateforme pour les gens curieux, avec une soif de se divertir et de s'informer »,
Le site d'information BuzzFeed News ferme ses portes. C'est ce qu'a annoncé la direction du groupe de divertissement BuzzFeed, jeudi 20 avril.
Le site d'information BuzzFeed News ferme ses portes. C'est ce qu'a annoncé la direction du groupe de divertissement BuzzFeed, jeudi 20 avril.
Les jeunes streamers s'imposent sur la plateforme de streaming, par le biais d'une stratégie média puissante.
Les jeunes streamers s'imposent sur la plateforme de streaming, par le biais d'une stratégie média puissante.
Comme chaque année, le Nieman Lab, le laboratoire du journalisme de Harvard, met en avant les prédictions médias des personnes les plus « brillantes »...
Comme chaque année, le Nieman Lab, le laboratoire du journalisme de Harvard, met en avant les prédictions médias des personnes les plus « brillantes » du milieu du journalisme américain. Voici notre sélection.
Laurent Bainier, journaliste à 20 minutes a un projet fou : décrypter le Web 3 en inventant un média complètement immergé dans le Web 3.
Laurent Bainier, journaliste à 20 minutes a un projet fou : décrypter le Web 3 en inventant un média complètement immergé dans le Web 3.
C'est un média à mi-chemin entre Vice, Konkini et Society que nous avons découvert en 2020 sur TikTok au moment où il se lançait en France. Urbania, vous connaissez ?...
C'est un média à mi-chemin entre Vice, Konkini et Society que nous avons découvert en 2020 sur TikTok au moment où il se lançait en France. Urbania, vous connaissez ? Au Canada, c'est un carton chez les jeunes et ça fait 20 ans que ça dure.
Dans ce 6e épisode de Story of Stories, nous décryptons le succès éditorial de Time To Sign Off, TTSO pour les intimes.
Dans ce 6e épisode de Story of Stories, nous décryptons le succès éditorial de Time To Sign Off, TTSO pour les intimes.
Auteur du livre Les 100 expressions à éviter au bureau & ailleurs, il anime également le Talk Décideurs du Figaro. Quentin Périnel est une des Top Voices de LinkedIn
Auteur du livre Les 100 expressions à éviter au bureau & ailleurs, il anime également le Talk Décideurs du Figaro. Quentin Périnel est une des Top Voices de LinkedIn
L'application ChatGPT représente-t-il une menace pour l'univers de la communication et des médias ? Story Jungle fait le point sur cette fascinante intelligence artificielle...
L'application ChatGPT représente-t-il une menace pour l'univers de la communication et des médias ? Story Jungle fait le point sur cette fascinante intelligence artificielle.
Comme chaque année, le festival Médias en Seine, organisé par le groupe les Echos-Le Parisien et France Info, rassemble les têtes du secteur médiatique...
Comme chaque année, le festival Médias en Seine, organisé par le groupe les Echos-Le Parisien et France Info, rassemble les têtes du secteur médiatique. On tente de prendre le pouls du secteur. Le but affiché de chaque édition : "répondre aux enjeux du monde de demain".
Il fait figure d'exception. Le New York Times vient d'annoncer 455 000 nouveaux abonnés au 3e trimestre 2021 (et prévoit un tassement de la croissance de ses revenus au prochain...
Il fait figure d'exception. Le New York Times vient d'annoncer 455 000 nouveaux abonnés au 3e trimestre 2021 (et prévoit un tassement de la croissance de ses revenus au prochain trimestre lestés par la chute des ventes papiers). Mais ces bons résultats ne reflètent pas la santé économique réelle des éditeurs.
Alors que Facebook annonce le recrutement de 10 000 personnes pour travailler sur son metaverse et va jusqu'à changer de nom pour souligner l'importance de son projet (appelez...
Alors que Facebook annonce le recrutement de 10 000 personnes pour travailler sur son metaverse et va jusqu'à changer de nom pour souligner l'importance de son projet (appelez-moi Meta), Story Jungle et Alexandre Michelin, fondateur du Kif-Knowledge Immerse Forum, s'interrogent sur la réalité des promesses de cette nouvelle forme d'Internet. Alors, retour à Second Life ou exploration d'une nouvelle Terra Incognita ?
Depuis 2013, il travaille dans le journalisme numérique et le développement de l'audience. Francesco Zaffarano est passionné par l'univers des médias et de l'innovation...
Depuis 2013, il travaille dans le journalisme numérique et le développement de l'audience. Francesco Zaffarano est passionné par l'univers des médias et de l'innovation. Il a été Instagram Producer chez The Economist, Social Media Editor chez Telegraph, Assistant video producer chez Vice Media ou encore journaliste au Corriere della Serra.
Une nouvelle génération d'influenceurs en ligne apparaît. De plus en plus de créateurs réalisent l'intérêt de couvrir l'actu sur leurs chaînes...
Une nouvelle génération d'influenceurs en ligne apparaît. De plus en plus de créateurs réalisent l'intérêt de couvrir l'actu sur leurs chaînes. Au détriment des médias traditionnels.
Les bots Twitter posent un gros problème à Elon Musk. C'est en tout cas ce qu'il prétend.
Les bots Twitter posent un gros problème à Elon Musk. C'est en tout cas ce qu'il prétend.
Le Nieman Lab fournit son lot de prédictions pour l'année à venir.
Le Nieman Lab fournit son lot de prédictions pour l'année à venir.
« Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. » C'est par ces mots de Winston Churchill que Mathias Vicherat,...
« Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. » C'est par ces mots de Winston Churchill que Mathias Vicherat, directeur de l'Institut d'études politiques de Sciences Po a ouvert la 12e édition des Nouvelles pratiques du journalisme, consacrée cette année à la reconquête du terrain.
Une histoire d'amour longue de 27 années : entre France Info et Jérôme Colombain, c'est fini ! Le journaliste tech a décidé de lancer son propre podcast, �...
Une histoire d'amour longue de 27 années : entre France Info et Jérôme Colombain, c'est fini ! Le journaliste tech a décidé de lancer son propre podcast, « Monde numérique ». Alors que la radio subit la crise, le média vient de fêter le centenaire de la première édition de Radio Tour Eiffel. Avec lui, nous avons parlé de l'avenir de l'audio et de ses axes de développement : réseaux sociaux, objets connectés et Clubhouse.
Podcasts, smartphones, réseaux sociaux et pandémie : l'étude du Reuters Institute revient sur une année marquée par le Covid et les restrictions.
Podcasts, smartphones, réseaux sociaux et pandémie : l'étude du Reuters Institute revient sur une année marquée par le Covid et les restrictions.
Les médias trouvent leur public sur TikTok. Avec des recettes très simples.
Les médias trouvent leur public sur TikTok. Avec des recettes très simples.
Le Washington Post n'est désormais plus le seul média star sur TikTok. Ils sont quelques-uns à avoir atteint plus d'un million de followers sur la plateforme.
Le Washington Post n'est désormais plus le seul média star sur TikTok. Ils sont quelques-uns à avoir atteint plus d'un million de followers sur la plateforme.
À tout juste 44 ans, Mathieu Gallet a derrière lui une vie bien remplie. Il a aussi bien côtoyé le monde politique - en tant que directeur de cabinet adjoint de Frédéric...
À tout juste 44 ans, Mathieu Gallet a derrière lui une vie bien remplie. Il a aussi bien côtoyé le monde politique - en tant que directeur de cabinet adjoint de Frédéric Mitterrand alors ministre de la Culture – que celui, tumultueux des médias : Canal + , ou encore l'INA dont il a été (très) jeune président. On retiendra surtout sa nomination comme PDG de Radio France en 2014. Aujourd'hui, après une éviction brutale, le phœnix renaît de ses cendres.
Le rapport annuel du Reuters Institute – le centre de recherche en journalisme de l'université d'Oxford – avec ses observations et ses prédictions pour l'année à venir...
Le rapport annuel du Reuters Institute – le centre de recherche en journalisme de l'université d'Oxford – avec ses observations et ses prédictions pour l'année à venir vient de sortir. L'étude, très riche, s'appuie sur le témoignage de 234 leaders des médias digitaux – rédacteurs en chef, Managing Directors, Heads of Digital... – de 43 pays. Quelles priorités se dessinent pour l'année 2021 en termes de narration ?
Jamais les médias n'ont été autant lus, regardés, consommés. Face à une crise sanitaire sans précédent, ils ont joué un rôle d'accompagnateur auprès d'une audience avide...
Jamais les médias n'ont été autant lus, regardés, consommés. Face à une crise sanitaire sans précédent, ils ont joué un rôle d'accompagnateur auprès d'une audience avide de décryptages et d'informations pratiques.
Arno Pons est le délégué général du think-tank "Digital New Deal". Une fondation dont le but est de "créer un Internet des Lumières, européen et humaniste"...
Arno Pons est le délégué général du think-tank "Digital New Deal". Une fondation dont le but est de "créer un Internet des Lumières, européen et humaniste". Il plaide pour une circulation des données personnelles sous le "strict contrôle des individus". L'heure est à la défense d'une souveraineté numérique. Il a échangé sur le sujet avec Gilles Prigent, directeur de l'agence Story Jungle. Le live est à voir sur LinkedIn (spoiler alert : quelques problèmes techniques altèrent le son de la vidéo)
Face à la crise du coronavirus, les médias prennent l'eau (notamment parce que les annonceurs ne souhaitent pas être associés au coronavirus comme évoqué précédemment dans...
Face à la crise du coronavirus, les médias prennent l'eau (notamment parce que les annonceurs ne souhaitent pas être associés au coronavirus comme évoqué précédemment dans notre enquête), et cherchent activement des solutions. Story Jungle prend le pouls de cette situation inédite. Tour d'horizon d'un écosystème éprouvé.
Aider son prochain. Tel pourrait être le nouveau mantra des marques, en ces temps agités. Plutôt que de promouvoir tel ou tel service, elles doivent « profiter »...
Aider son prochain. Tel pourrait être le nouveau mantra des marques, en ces temps agités. Plutôt que de promouvoir tel ou tel service, elles doivent « profiter » de cette période pour mettre en valeur leur « raison d'être », c'est-à-dire le sens profond qu'une entreprise donne à son activité. « Il faut une réaction, il faut que les marques continuent d'exister pendant la crise », intime Pierre Gomy, directeur chargé des marques chez Kantar France. « Quelle que soit la réponse, l'essentiel est qu'elle soit authentique, en phase avec la personnalité de la marque », indique-t-il à l'AFP.
Harvard Business Review vient de lancer sa propre chaîne de télévision sur LinkedIn.
Harvard Business Review vient de lancer sa propre chaîne de télévision sur LinkedIn.
Certains ont encore foi en l'avenir des médias. A l'approche de la présidentielle, des petits nouveaux pointent le bout de leur nez, soutenus pour certains par des investisseurs...
Certains ont encore foi en l'avenir des médias. A l'approche de la présidentielle, des petits nouveaux pointent le bout de leur nez, soutenus pour certains par des investisseurs solides. Story Jungle a dressé un inventaire.
Suivez-nous
|